Recension : Stéphane Le Lay et Fabien Lemozy, Plateformes. La colonisation du travail et de la démocratie (2025, Éditions de l’Atelier)
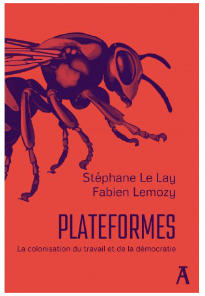
Stéphane Le Lay et Fabien Lemozy (2025), Plateformes. La colonisation du travail et de la démocratie, Paris, Éditions de l’Atelier, 248 p.
Recension version post-print par
Clément Le Ludec
leludec.clement@gmail.com
Chercheur postdoctoral, sociologie, Université Paris-Panthéon-Assas, CERSA, 12 place du Panthéon, 75231 Paris cedex 5, France ;
Réunissant plusieurs enquêtes réalisées au cours des sept dernières années, Stéphane Le Lay et Fabien Lemozy analysent la « colonisation du travail et de la démocratie » par les plateformes. En croisant des perspectives tirées de la sociologie et de la psychologie du travail, les auteurs s’intéressent à « la manière dont les plateformes agissent sur la subjectivité des micro-entrepreneurs, pour en réduire les voies d’expression, d’épanouissement » et pointent « les dangers qu’une telle colonisation subjective fait courir au vivre-ensemble aussi bien démocratique qu’écologique » (p. 14). La méthodologie repose sur deux vagues d’enquêtes par entretiens, ainsi que sur une approche clinique fondée sur des réunions collectives avec les mêmes participants. Une forte hétérogénéité des profils a été constatée entre les deux vagues. La première vague en 2020 concernait principalement de jeunes livreurs français en quête de revenus d’appoint (N = 6) ; la seconde en 2023 marque un tournant, avec une précarisation accrue et une majorité de travailleurs sans papiers (N = 8).
Le premier chapitre de l’ouvrage porte sur le nouveau mode de gouvernement des travailleurs instauré par les plateformes numériques. Il s’agit de montrer « comment les plateformes ont réussi à s’assurer de l’engagement des travailleurs dans les activités en jouant sur trois grands leviers : la séduction, l’éclatement des collectifs de travail et la colonisation subjective » (p. 18). Le premier levier repose sur la mise en scène d’un métier « cool », celui de coursier à vélo, valorisé par une esthétique urbaine, une liberté apparente et une souplesse d’organisation. Ce discours de séduction participe à légitimer un travail précaire et physiquement éprouvant, en le rendant désirable. Le deuxième levier, plus ambigu, renvoie à la « colonisation subjective » des travailleurs, un concept mobilisé mais insuffisamment défini dans le chapitre. Cette colonisation se manifeste notamment par la gamification des interfaces, l’usage systématique de métriques de performance et une gestion algorithmique du temps qui induit des phases d’attente frustrantes et non rémunérées. Ces mécanismes rappellent les analyses sur le free labour des travailleurs de plateformes, caractérisés par la réalisation d’activités nécessaires mais non rémunérées, travaux qui auraient mérités d’être discutés. Le troisième levier, enfin, concerne l’éclatement des collectifs de travail, produit par la mise en concurrence algorithmique des livreurs. Si cette tendance est bien décrite, on peut regretter que le chapitre n’aborde pas davantage les stratégies de contournement mises en œuvre par les travailleurs – braconnage des règles, entraide ponctuelle, ou encore tentatives d’organisation collective. En revanche, l’analyse des effets de ce régime de travail sur les corps et les esprits est particulièrement intéressante et rejoint le corpus de littérature scientifique et administrative ayant mis en avant ces problèmes : les auteurs décrivent avec précision les douleurs physiques liées à l’usage intensif du vélo, la détérioration de la santé mentale, mais aussi les conséquences sur la vie privée, comme par exemple le divorce.
Dans le deuxième chapitre, les auteurs prolongent leur analyse défendant la thèse selon laquelle la domination algorithmique n’est pas uniquement une technique de gestion du travail, mais un mécanisme plus large d’extension de l’emprise marchande sur les subjectivités, entravant toute possibilité d’émancipation collective. Le propos prend une dimension plus systémique, visant à généraliser ce que les plateformes représentent dans l’ensemble des technologies numériques : des dispositifs qui, loin de se limiter à organiser un marché, participent à une reconfiguration profonde des rapports sociaux et politiques. Les plateformes véhiculeraient ainsi une « conception de l’être humain » qui « accélère la destruction méticuleuse des soubassements de l’État de droit et de l’État social » (p. 93-94), au point d’en faire de véritables « contempteurs de la démocratie » (p. 97). Les auteurs montrent que les travailleurs déploient des stratégies défensives, notamment via une appropriation ambivalente de la rhétorique entrepreneuriale promue par les plateformes, qui loin de libérer, renforce souvent leur sujétion. Ainsi, même une adhésion partielle ou contrainte à ce « micro-entrepreneuriat plateformisé » (p. 111) contribue à enfermer les travailleurs dans un cadre normatif rigide et faussement émancipateur. Cette configuration rejoint les analyses de Silvio Lorusso[1] sur l’« entreprecariat », qu’il définit comme une situation paradoxale où les discours incitatifs à l’entrepreneuriat se diffusent en masquant, sous couvert d’autonomie, des formes structurelles de précarisation.
Les auteurs inscrivent cette dynamique dans un contexte plus large de segmentation du marché du travail, où les inégalités structurelles se creusent, en particulier pour les femmes et les travailleurs migrants, déjà en situation de vulnérabilité. Ainsi, concernant le genre, l’analyse souligne l’importance de la division sexuée de l’espace public et des discours virilistes, notamment dans les activités mobilisant l’imaginaire sportif. Afin d’approfondir cet argument, cet aspect du travail des livreurs à vélo aurait gagné à être mis en perspective avec d’autres travaux qui soulignent combien le travail de plateforme s’avère profondément inégalitaire du point de vue du genre et ce, quel que soit le type d’activité exercée. Dans le travail en ligne (micro-travail), Paola Tubaro et ses collègues[2] ont notamment montré que cette activité s’articule avec les contraintes du travail domestique, renforçant la précarité des micro-travailleuses par une double assignation : à la sphère reproductive et à une activité rémunérée socialement peu valorisée. Ces inégalités se retrouvent également dans le niveau de rémunération. Finalement, les plateformes tendent à calquer et à amplifier des inégalités préexistantes.
Par ailleurs, si le chapitre avance une critique politique forte du rôle des plateformes dans l’érosion des bases démocratiques – en les qualifiant notamment de « contempteurs de la démocratie » – cette affirmation aurait gagné en légitimité si elle avait été accompagnée d’une analyse plus poussée des dynamiques de régulation en cours. Le manque de discussion sur les politiques publiques concernant le statut des travailleurs des plateformes est d’autant plus dommageable que certaines affirmations paraissent excessives, voire infondées : par exemple, la description de l’ARPE comme une simple « blague » ou comme un outil au service du gouvernement pour légitimer un « tiers statut » (p. 132) n’est étayée par aucune source académique ou empirique.
Ces éléments sont repris dans le troisième chapitre dans lequel les auteurs proposent une montée en généralité sur les effets politiques de la plateformisation, qu’ils analysent comme un véritable « sabotage de la démocratie », signe de l’entrée dans un « capitalisme dystopique » (p. 138). Ils suggèrent que l’État favorise activement l’extension du capitalisme de plateforme à des pans entiers de la vie sociale, concrétisant ainsi le rêve néolibéral d’un marché affranchi de toute contrainte démocratique (p. 18). Les auteurs y développent notamment les « dispositifs disciplinaires » (p. 167) mis en place pour encadrer le travail des livreurs comme celui des clients, contribuant in fine à renforcer leur exploitation. Les applications calculent des métriques de performance et intègrent les évaluations des clients afin de contrôler leur flotte de livreurs. Ce système d’évaluation constitue une forme de management algorithmique, dans la mesure où ces indicateurs sont utilisés pour récompenser (par des primes) ou sanctionner les livreurs (jusqu’à la désactivation de leur compte). Cette section repose néanmoins principalement sur la littérature académique et gagnerait à être étayée par des données de terrain.
Dans ce même chapitre, l’ouvrage souligne également le rôle actif des politiques publiques françaises, en particulier via la promotion du statut d’auto-entrepreneur et le soutien explicite aux plateformes sous les gouvernements de « l’ère Macron » (p. 185). Cette perspective permet de dépasser l’idée d’un simple retrait de l’État : ce dernier agit ici comme facilitateur de la plateformisation, légitimant une politique de « mise au travail » et de dérégulation sectorielle, tel le cas d’Uber face aux taxis. À cet égard, la France se distingue par une posture particulièrement favorable aux plateformes, y compris au sein des négociations européennes, où elle s’est opposée aux tentatives de régulation ambitieuses menées par d’autres États membres. Cette lecture s’inscrit dans une critique désormais bien établie du faux travail indépendant, central dans les discours de légitimation des plateformes. Elle prolonge l’analyse de Karl Polanyi[3], qui voit dans la marchandisation du travail un processus nécessitant l’instauration de dispositifs institutionnels destinés à désamorcer les résistances sociales et à généraliser la logique marchande.
En définitive, l’ouvrage éclaire avec force la manière dont les dispositifs numériques agissent sur les subjectivités et fragilisent les fondements démocratiques. Néanmoins, la portée des résultats se heurte à certaines limites méthodologiques : l’enquête repose sur un échantillon restreint, centré sur un secteur (la livraison). Cela ne permet pas, en l’état, de tirer des conclusions généralisables sur l’ensemble des dynamiques de plateformisation du travail. En effet, cette présentation homogène de la plateformisation néglige la diversité des situations de travail et des configurations organisationnelles qu’elle recouvre. Comme le soulignent plusieurs travaux récents, le concept même de « plateforme » capte très imparfaitement un ensemble de réalités sociales qui relèvent plus largement de dynamiques d’externalisation et de numérisation du travail. La question posée par Maxime Cornet et ses collègues[4] – peut-on réellement regrouper sous une même appellation des travailleurs aux rythmes, activités, statuts et secteurs radicalement différents ? – aurait ici mérité d’être discutée. En ce sens, un effort analytique plus poussé sur ce qui distingue et ce qui rapproche les plateformes dans différents secteurs aurait permis de renforcer l’argumentaire.
De même, si les auteurs abordent la colonisation subjective et la captation de l’autonomie des travailleurs, ils exploitent peu un levier pourtant central : celui du travail gratuit. Les logiques de mise en visibilité, de disponibilité constante ou encore de participation sans rétribution participent à une reconfiguration du travail qui dépasse les seules formes classiques d’emploi. Cette perspective pourrait également être articulée aux réflexions issues des théories du colonialisme des données, qui décrivent l’émergence d’un ordre visant à capter et extraire des ressources sociales à des fins lucratives, par le biais des données. Dans ce cadre, le travail gratuit devient un vecteur central de la création de valeur, notamment via la captation des traces numériques laissées par les utilisateurs.
Enfin, l’usage du terme de « colonisation » aurait mérité d’être introduit et discuté plus en amont, ainsi que davantage problématisé au fil de l’ouvrage. Une telle discussion aurait pu s’articuler aux travaux qui analysent les plateformes comme un élément d’un système de délocalisation croissante du travail, reposant largement sur la main-d’œuvre des pays du Sud, ainsi que sur des travailleurs migrants précaires, parfois sans papiers. Si les auteurs identifient cette dimension, elle gagnerait à être davantage théorisée dans une perspective postcoloniale, en dialogue avec les approches critiques qui interrogent les chaînes de sous-traitance mondialisées comme des formes contemporaines de colonialité du travail.
- Silvio Lorusso (2019), Entreprecariat? Everyone Is an Entrepreneur, Nobody Is Safe, Eindhoven, Onomatopee. ↑
- Paola Tubaro, Marion Coville, Clément Le Ludec et Antonio A. Casilli (2022), « Hidden Inequalities. The Gendered Labour of Women on Micro-tasking Platforms », Internet Policy Review, vol. 11, no 1, p. 1-26. ↑
- Karl Polanyi (2001), The Great Transformation. The Political and EconomicOorigins of our Time (second edition), Boston, MA, Beacon Press. ↑
- Maxime Cornet, Clément Le Ludec, Elinor Wahal, Mandie Joulin (2022), « Beyond “Platformisation”. Designing a Mixed-methods Approach to Inspect (Digital) Working Conditions through Organisational Systems », Work Organisation, Labour & Globalisation, vol. 16, no 1, p. 52-71. ↑