Recension : Célia Bouchet et al. (dir.), La Théorie féministe au défi du handicap. Recueil de textes des feminist disability studies (2025, Cambourakis)
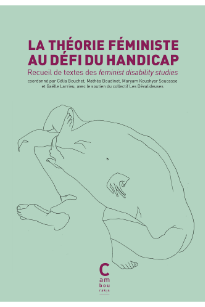
Célia Bouchet, Mathéa Boudinet, Maryam Koushyar & Gaëlle Larrieu, avec le soutien du collectif Les Dévalideuses (2025), La Théorie féministe au défi du handicap. Recueil de textes des feminist disability studies, Paris, Cambourakis, 224 p.
Recension version post-print par
Emmanuelle Fillion
emmanuelle.fillion@ehesp.fr
Professeure de sociologie à l’EHESP, Campus Paris Santé, 2-10 rue d’Ouradour-sur-Glane, 75015 Paris-93210 La Plaine Saint-Denis, France
Cet ouvrage collectif s’organise autour de deux visées majeures. La première est d’éclairer l’impensé du handicap dans les théories féministes encore très présent, en particulier en France. Il s’agit ici d’enrichir à la fois les études de genre au prisme du handicap et les études sur le handicap au prisme du féminisme. La seconde visée répond à un impératif d’accessibilité et de science participative. Élaboré par un groupe de jeunes chercheuses spécialistes du handicap en collaboration avec un collectif handi-féministe, le livre donne à lire, au-delà des cercles universitaires, des textes fondamentaux des feminist disability studies qui n’étaient jusqu’alors disponibles qu’en anglais dans des bases de données universitaires.
Le recueil débute par une introduction « Pour penser le féminisme et le handicap » qui présente de façon synthétique le cadre général des disability studies, les différents courants qui l’ont animé. Puis elle identifie la source principale de points aveugles ou de tensions entre les études sur le genre et les études sur le handicap : l’absence de femmes handicapées parmi les mobilisations féministes et théoriciennes du genre. Les feminist disability studies « sous ensemble méconnu des disability studies » (p. 28), permettent précisément d’ouvrir le dialogue en envisageant le handicap, non comme « un rapport de pouvoir comme un autre [mais] comme un rapport social transversal au même titre que le genre, la classe ou la race » (p. 24).
Est ensuite présentée la traduction de six textes, rédigés par sept auteures, toutes directement concernées par le handicap, six d’entre elles étant des chercheuses handicapées, la septième étant la mère d’une jeune femme handicapée. Ces articles témoignent de ce que l’expérience concrète du handicap a produit comme inflexion dans les trajectoires de recherche, parfois de mobilisation, des unes et des autres. Ils ont été publiés entre les années 1980 et les années 2000 : ils ne sont donc pas récents mais sont choisis pour être des textes fondateurs des feminist disability studies.
Le premier article de Michelle Fine et Adrienne Asch « Femmes handicapées : le sexisme sans le piédestal » est paru en 1981[1]. Il objective d’abord les inégalités spécifiques aux femmes handicapées au regard des autres femmes et des hommes handicapés. Outre une situation d’inégalités structurelles, ces femmes sont exclues des rôles socialement prescrits de séduction et de maternité. Or, si le féminisme a pu en « libérer » les femmes valides, ce fut au prix de l’invisibilisation des femmes handicapées. Les auteures pointent un tabou et une injustice à réparer : « bien que le fait de ne pas avoir de rôles socialement prescrits à rejeter puisse sembler une bénédiction, ne pas en avoir peut engendrer un sentiment d’invisibilité, d’éloignement de soi et/ou d’impuissance » (p. 45).
Le deuxième texte « Vers une théorie féministe du handicap » a été publié en 1989 par Susan Wendell[2]. Elle affiche d’emblée un point de vue situé de femme devenue handicapée et propose de mobiliser la maxime féministe « le privé est politique » pour déconstruire l’altérisation et la marginalisation des personnes handicapées, hommes ou femmes, et plus largement « l’oppression du corps par une société et sa culture » (p. 92). Ce texte porte le premier coup, dans le corpus proposé, au modèle social « pur et dur » du handicap – qui dissociait radicalement déficience et handicap – et à l’idéal d’autonomie des personnes handicapées promus par les premières disability studies.
Dans « La chance de vivre » paru en 1991[3], Jenny Morris analyse « l’incapacité du féminisme à prendre en compte les intérêts des personnes handicapées » (p. 93) dans son traitement de l’avortement et l’acceptation muette du dogme selon lequel tout diagnostic de handicap est une motivation suffisante (quand ce n’est pas une incitation ferme) à l’interruption de grossesse. Jenny Morris montre combien cet impensé contribue à l’exclusion des personnes handicapées, en plus de faire reposer sur les femmes la responsabilité de la mise au monde (ou non) des enfants concernés. Elle propose alors une réflexion qui articule le point de vue des personnes handicapées au point de vue féministe sur le dépistage, l’avortement et le consentement.
Dans « Féminisme et handicap : portée théorique et politique du personnel et de l’expérientiel » paru en 2001[4], Carol Thomas invite à « prendre des éléments de l’épistémologie féministe et d’autres perspectives théoriques, empiriques et politiques [pour] les appliquer au champ des disability studies » (p. 118). Comme Susan Wendell, Carol Thomas oppose « le personnel est politique » en réponse aux premiers théoriciens du modèle social (tous des hommes) pour promouvoir un nouveau modèle social du handicap qui n’ignore plus l’expérience du corps déficient.
Le cinquième texte de Rosemarie Garland-Thompson, « Intégrer le handicap, transformer le féminisme » paru en 2002[5], fustige l’ignorance réciproque entretenue par les travaux des théoriciennes féministes et les disability studies et propose un programme de recherche interdisciplinaire pour « étudier la façon dont la culture imprègne de significations les particularités du corps » (p. 142-143), interroger les catégories fixistes des sujets et soutenir « l’intersectionnalité du féminisme » (p. 144).
Dans son article paru en 2006, « L’éthique du care en biomédecine. Le cas du handicap[6] », Eva Feder-Kittay propose de réhabiliter la notion de care développée par les théories féministes au sein des disability studies et de tirer parti des travaux de ces dernières, comme de son expérience personnelle, pour envisager un care qui ne soit pas une éthique de soumission mais une éthique émancipatoire des receveurs comme des pourvoyeurs. Elle convoque un sujet relationnel, des « dépendances interconnectées » (p. 190) et invite à assumer la question des inégalités concrètes en valorisant les compétences morales et émotionnelles.
Sans douter que d’autres textes auraient eu toute leur place dans cet ouvrage, ceux qui sont traduits ici s’avèrent particulièrement heuristiques, en eux-mêmes et par les échos comme les pas de côté qu’ils produisent les uns vis-à-vis des autres. Il est difficile dans un court compte-rendu de rendre justice à leur richesse. La pertinence du choix opéré tient entre autres au fait qu’ils s’attaquent frontalement aux « questions qui fâchent » les feminist studies et les disability studies pour les faire dialoguer. L’intérêt est double.
Premièrement, les approches féministes permettent aux disability studies de renouveler le modèle social du handicap, en incorporant le corps, la déficience et toutes les réalités du handicap, y compris la souffrance : « On ne devrait pas nous amener à nier ces aspects négatifs pour affirmer que nos vies ont de la valeur. Pour ma part, j’estime que même si l’environnement physique dans lequel je vis ne présentait aucun obstacle physique, je préfèrerais quand même pouvoir marcher. Même si la société ne me discriminait pas, le fait de pouvoir marcher m’offrirait plus de choix et d’expériences que le fait de ne pas pouvoir marcher. Cependant, cela ne veut absolument pas dire que ma vie ne vaut rien, ni que je refuse de reconnaître que des choses très positives se sont produites dans ma vie parce que je suis devenue handicapée », écrit Jenny Morris (p. 101).
Deuxièmement, ce sont aussi les théories féministes qui bénéficient du prisme du handicap, en l’appréhendant notamment comme « un système culturel omniprésent qui stigmatise certains types de variations corporelles » et qui « légitime une distribution inégale des ressources, du statut et du pouvoir dans un environnement social et architectural biaisé » souligne Rosemarie Garland-Thompson (p. 145-146). Il s’agit aussi d’aiguillonner les études féministes dans une dynamique intersectionnelle : « Pour construire une théorie féministe qui tienne compte de nos différences, nous avons besoin de savoir comment le handicap et l’oppression sociale qui y est liée interagissent avec le sexisme, le racisme, le classisme », selon Susan Wendell (p. 61).
Cette assise confère au recueil une portée théorique et politique générale, au-delà des cercles dédiés au handicap ou au féminisme, qu’ils soient militants ou académiques. D’abord, parce que ces six textes montrent l’intérêt scientifique d’un point de vue situé des chercheuses. On citera de façon non exhaustive, Jenny Morris qui témoigne de son déplacement sur la question de l’avortement quand elle est devenue handicapée, Rosemarie Garland-Thompson qui propose de substituer une « théorie minorisante » à une « théorie universalisante », Eva Feder-Kittay qui revendique l’articulation de ses travaux sur le care à son expérience de mère d’une fille handicapée pour substituer une éthique du care contextualisée à une éthique de la justice de portée universelle inspirée de l’impératif moral kantien. L’articulation des études de genre et des études sur le handicap invite à traiter des problématiques en situation plutôt qu’en généralité. En rendant compte des bonnes raisons de ramener l’expérience personnelle dans le travail théorique, ces auteures mettent à nu des présupposés non explicités dans les théories universalisantes. Carol Thomas dévoile ainsi une approche scientiste et une illusion de neutralité et d’objectivité partagées par les premières disability studies (qui voulaient dissocier radicalement handicap et déficience) et les médecins et professionnels du handicap (qui voulaient au contraire les mettre en équivalence). Il s’agit aussi de comprendre la diversité des vies vécues avec une déficience plutôt que participer à l’effacement des différences et du « vrai corps » pour Susan Wendell (p. 74) sous la catégorie de handicap ou de femme, de comprendre et donc de pouvoir contester les différentes formes de validisme, d’enrichir les approches intersectionnelles en prêtant attention à d’autres différences. Cette posture assume des réponses provisoires à des questions complexes et parfois embarrassantes, comme celle des rôles féminins stéréotypés, de l’avortement ou du travail de care. L’ouvrage alimente également une analyse critique de valeurs considérées comme des biens supérieurs dans les sociétés contemporaines, telles que l’individualisme, l’indépendance et l’autonomie. Susan Wendell et Eva Feder-Kittay notamment en montrent le caractère fondamentalement irréaliste et idéologique et plaident en faveur d’un modèle de réciprocité et d’interdépendance. À rebours des critiques qui ont pu leur être adressées, les feminist disability studies témoignent donc ainsi d’une grande vitalité politique et conceptuelle.
Le choix de ces textes élaboré conjointement par les chercheuses et les activistes participe au dialogue entre sciences et société et s’avère très utile à toutes les personnes qui s’intéressent au handicap et/ou au féminisme, tant dans le domaine de la recherche que de l’action militante. Mais ce travail intéresse plus largement les sciences humaines et sociales et la question de la transformation politique et sociale.
En refermant l’ouvrage, on peut ressentir une petite pointe de frustration en l’absence de postface qui explicite comment se sont construites la distribution et la coordination du travail au sein du collectif entre chercheuses académiques et militantes, les débats et modalités de décision qui ont eu lieu et les leçons tirées de cette expérience. Mais cette frustration est bien le signe que les auteures ont su susciter l’envie de poursuivre ce dialogue heuristique et on ne peut que les inviter à la publication d’un article méthodologique sur l’élaboration originale de l’ouvrage.
- Michelle Fine, Adrienne Asch (1981), « Disabled Women. Sexisme without the Pedestal », The Journal of Sociology & Social Welfare, vol. 8, no 2, p. 233-248. ↑
- Susan Wendell (1989), « Toward a Feminist Theory of Disability », Hypatia, vol. 4, no 2, p. 104-124. ↑
- Jenny Morris (1991), « The Chance of Live », Pride against Prejudice. Transforming Attitude to Disability, Londres, The Women’s Press, p. 45-56. ↑
- Carol Thomas (2001), « Feminism ans Disability. The Theorical and Political Signifiance of the Personnal and the Experimental », in Barton L. (dir.), Disability, Politics and the Struggle for Change, Londres, Routledge, p. 48-58. ↑
- Rosemarie Garland-Thomson (2002), « Integrating Disability, Transforming Feminist Theory », NWSA Journal, vol. 14, no 3, p. 1-32. ↑
- Eva Feder-Kittay (2006), « The Concept of Care Ethics in Biomedecine. The Case of Disability », in Rehmann-Sutter C., Düwell M. & Mieth D. (dir.), Bioethics in Cultural Contexts, Dordrecht, Springer, p. 319-339. ↑