Recension : Arnaud Pierrel, Ingénieurs mais apprentis (2024, Classiques Garnier)
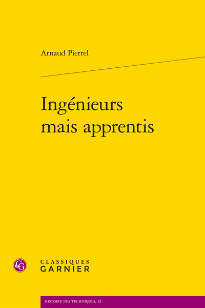
Arnaud Pierrel (2024), Ingénieurs mais apprentis, Paris, Classiques Garnier, 244 p.
Recension version post-print par
Joachim Benet Rivière
joachim.benet@live.fr
Chercheur post-doctoral, Laboratoire GRESCO ; GRESCO-POITIERS, 36 rue de la chaîne, TSA 81118, 86073 Poitiers cedex 9, France ;
Le nombre d’apprentis a connu une augmentation significative au cours des dernières années. À titre d’exemple, à la fin du mois de janvier 2025, plus d’un million de personnes étaient engagées dans un contrat d’apprentissage. Si, historiquement, ce mode de formation était associé à un diplôme spécifique, le certificat d’aptitude professionnelle (CAP), il a progressivement élargi son périmètre pour englober de nombreux diplômes traditionnellement préparés par la voie scolaire. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les formations supérieures. En prenant l’exemple des écoles d’ingénieurs, pionnières dans cette évolution, Arnaud Pierrel examine les effets du développement de ce mode de formation sur le positionnement de ces écoles et sur la valeur de leurs diplômes. Il cherche à comprendre si l’apprentissage est encore perçu comme une « voie de garage » pour les étudiants qui seraient en difficulté, et si cette évolution remet en cause le rôle traditionnel des écoles d’ingénieurs dans la formation d’une « élite scolaire ».
Pour répondre à ces interrogations, Arnaud Pierrel s’appuie sur une grande diversité de sources, collectées au cours d’une enquête menée entre 2014 et 2018. Ces sources comprennent des archives écrites et orales, des données statistiques sur les apprentis, ainsi que des entretiens semi-directifs réalisés auprès des promoteurs de l’apprentissage dans ces écoles. Ces éléments lui ont permis de constituer une base de données pour chaque école, intégrant notamment les profils des étudiants et des enseignants. En complément, une enquête de terrain a été menée directement auprès des apprentis ingénieurs, incluant l’observation des processus de recrutement, l’administration de questionnaires et la réalisation d’entretiens. L’ouvrage s’articule autour de cinq chapitres, chacun contribuant à éclairer un aspect particulier de cette mutation. Ils nous permettent de saisir progressivement la genèse et le développement de l’apprentissage dans ces écoles d’ingénieurs, puis ses effets sur les recrutements et les parcours des apprentis ingénieurs.
Le premier chapitre restitue le cadre légal du décloisonnement de l’apprentissage et les facteurs ayant contribué à son essor dans l’enseignement supérieur. Arnaud Pierrel souligne que ce décloisonnement de l’apprentissage a impliqué un « désarrimage de celui-ci de l’enseignement professionnel ». Ce processus de décloisonnement a d’ailleurs été consacré par la loi du 23 juillet 1987, qui, deux années après la création du baccalauréat professionnel, a étendu l’apprentissage à tous les diplômes, y compris ceux du supérieur. Présentée comme un outil dans la lutte contre le chômage des jeunes, la formation en apprentissage avait déjà fait l’objet de discussions antérieures et d’expériences retracées par Arnaud Pierrel visant à assurer son développement dans l’enseignement professionnel (notamment avec la mise en place des « CAP connexes » et l’élargissement de l’apprentissage au baccalauréat professionnel). Au-delà de l’enseignement professionnel, l’apprentissage se retrouve ensuite dans des institutions spécialisées et localisées. Arnaud Pierrel souligne que les apprentis de l’enseignement supérieur ne sont cependant pas les mêmes que « ceux du bas ». Bien qu’ils ne représentent que 22 % des apprentis du supérieur en 2008, les bacheliers professionnels ont plus de dix fois plus de chances d’accéder à l’enseignement supérieur par l’apprentissage que par une autre voie. Ainsi, l’apprentissage dans le supérieur participe à une « démocratisation ségrégative », pour reprendre la notion de Pierre Merle, car il favorise l’ouverture de l’accès au supérieur à ces bacheliers mais dans des espaces bien spécifiques.
À partir du cas des instituts des techniques d’ingénieur de l’industrie (ITII), le deuxième chapitre décrit la mise en œuvre concrète de l’apprentissage dans les écoles d’ingénieurs en analysant les évolutions du rôle des CFA dans cette expansion, puis leur mode de financement via la taxe d’apprentissage notamment. Il souligne que la légitimité académique des CFA et de l’apprentissage ne va pas de soi dans les écoles d’ingénieurs. Dans une logique de légitimation, l’apprentissage s’appuie sur des formations qui ont fait l’objet d’une reconnaissance préalable, celles préparées par voie scolaire. C’est le cas notamment pour la première formation en apprentissage en école d’ingénieurs, ouverte au sein de l’Institut national agronomique de Paris-Grignon en 1995. Cette extension a par ailleurs contribué à redéfinir les fonctions des CFA, dont certains sont devenus de simples structures de gestion administrative, sans rôle pédagogique réel. Ils doivent eux-mêmes composer avec des institutions qui peuvent avoir, dans certaines configurations, un pouvoir coercitif sur leur fonctionnement. Tout comme les ITII qui n’ont pas d’existence préalable, les CFA encadrent des diplômes d’ingénieurs et forment « un espace dans l’espace » des écoles d’ingénieurs qu’Arnaud Pierrel reconstitue à l’aide d’une classification ascendante hiérarchique permettant de comprendre les logiques de recrutement qui font l’objet du chapitre suivant.
Le troisième chapitre se concentre sur le déroulement des processus de recrutement des apprentis. Ces processus sont considérés par l’auteur comme un « poste d’observation privilégié du “passé qui ne passe pas” de l’apprentissage », qui semble arrimé au bas de la hiérarchie scolaire engendrant « le spectre de ne former que des “sous-ingénieurs” ». Trois types d’acteurs interviennent dans le recrutement de ces apprentis et influent par conséquent sur leurs caractéristiques sociales : les ITTI, les écoles et les entreprises. À partir de l’observation d’une commission de sélection des dossiers des candidats et des entretiens menés avec quinze candidats admissibles et des listes d’admissibilité et d’admission, le sociologue a pu reconstituer les étapes de ce recrutement qu’il resitue dans leur contexte organisationnel, pour faire ressortir les catégories de jugement et la morphologie sociale des sélectionnés qu’elles produisent. Au cours des entretiens de recrutement, les candidats sont davantage évalués sur leurs qualités relationnelles et comportementales que sur leurs compétences purement techniques. Cette focalisation traduit des intérêts partagés entre les écoles d’ingénieurs et les ITII : il s’agit de consolider la légitimité académique de la formation par apprentissage en construisant une distinction nette avec le profil du technicien. Arnaud Pierrel montre ainsi que ces processus de sélection participent à l’établissement d’une frontière sociale symbolique entre les apprentis ingénieurs et les techniciens, frontière rendue particulièrement visible dans les entretiens, où certains candidats peuvent être implicitement perçus ou disqualifiés comme de « simples techniciens ».
Le quatrième chapitre approfondit cette différenciation en examinant les spécificités sociales et scolaires des apprentis. Les données statistiques sur le supérieur dans sa globalité ne permettent pas d’observer des différences significatives entre les étudiants diplômés sous statut scolaire et ceux sous statut apprenti. Toutefois, les résultats de l’enquête par questionnaire réalisée par Arnaud Pierrel dans un établissement font apparaître que les apprentis ingénieurs ont des origines sociales plus populaires que ceux sous statut scolaire, et qu’ils sont pour la grande majorité d’entre eux passés par une STS ou un IUT avant leurs études d’ingénieur. Il souligne néanmoins que les filles connaissent une forme de sursélection sociale en apprentissage car elles ont plus souvent des pères qui occupent des positions de cadres supérieurs ou de professions libérales. Chez les apprentis, Arnaud Pierrel note une surreprésentation des trajectoires d’ascension sociale chez les pères par le diplôme en deux générations. L’analyse des questionnaires révèle des différences en termes de conditions d’étude et de vie, et souligne les effets de leur socialisation dans les projections professionnelles. Par ailleurs, cette « jeunesse au travail » se distingue aussi des ingénieurs sous statut scolaire parce qu’elle perçoit une rémunération (ce qui lui permet de s’affranchir davantage de la tutelle familiale en accédant à un logement autonome) et parce qu’elle n’a pas les mêmes aspirations professionnelles. Les apprentis sont davantage tournés vers le salariat, tandis que les ingénieurs sous statut scolaire aspirent plus souvent à des formes d’indépendance professionnelle.
Enfin, le dernier chapitre poursuit l’analyse de leurs spécificités en s’intéressant à leur passage de l’école au monde du travail. L’auteur y porte un regard critique sur le rôle formateur des entreprises, qui apparaît souvent limité à certains aspects de l’activité professionnelle. Confrontés au monde du travail dès le début de leur formation d’ingénieur, ces apprentis font déjà face à une première difficulté : celle de trouver un contrat d’apprentissage. Ces « salariés préclassés dans les rapports sociaux du monde du travail » qui sont définis comme des « mi-techniciens mi-ingénieurs » vont ensuite exercer ce premier emploi dans des grandes entreprises. Ils sont ainsi embauchés dans ces entreprises aux organigrammes complexes et ne croisent pas toujours leur maitre d’apprentissage dans leur quotidien. Comme on peut s’y attendre, leur supervision et les relations de formation, qui connaissent des variations importantes, restent soumises aux contraintes de la production et aux politiques du personnel dans ces entreprises. Ainsi, l’entreprise forme plutôt « à la condition salariale elle-même » sous différents aspects comme la recherche d’emploi, les relations hiérarchiques et les aléas de la production.
Le travail d’Arnaud Pierrel permet ainsi d’éclairer une facette des écoles d’ingénieurs largement ignorée jusqu’à présent par les travaux de recherche qui ont tendance à se focaliser sur les formations d’ingénieur les plus académiques, dont le recrutement est le plus sélectif socialement et qui sont également les plus prestigieuses. Celles-ci sont fondées sur une autonomie historique vis-à-vis du monde de l’entreprise. Le passage dans ces écoles permettrait l’obtention d’un titre scolaire prestigieux puis l’accès à des fonctions professionnelles élevées. Cette représentation des écoles d’ingénieurs doit être largement nuancée au regard du travail d’Arnaud Pierrel. Il inscrit pleinement les transformations de la morphologie sociale d’une partie de leurs publics en les situant dans le processus de massification de l’enseignement supérieur, qui affecte aussi ces établissements de formation. En effet, ces écoles d’ingénieurs ne sont plus des écoles formant uniquement une élite scolaire et sociale ; elles deviennent des espaces où l’on peut acquérir des titres professionnels à faible valeur symbolique. La riche enquête de terrain menée par Arnaud Pierrel permet aussi d’élargir la connaissance des apprentis au-delà du cas de l’enseignement professionnel en documentant l’expansion de cette catégorie de publics dans le supérieur.
On sait également que les écoles d’ingénieurs sont des espaces de la formation les moins ouverts aux filles, avec des variations selon les spécialités proposées au sein de ces écoles. Pourtant, les travaux sur les écoles d’ingénieurs prennent rarement en compte la variable sexe dans leur analyse des processus de socialisation scolaire et professionnelle. Il ne s’agit pas d’un reproche que l’on peut formuler à l’égard du travail d’Arnaud Pierrel. Ce dernier a le souci de documenter avec précision la construction des parcours scolaires et des aspirations des apprentis des deux sexes. Il apparait d’ailleurs que l’apprentissage a été intégré dans les écoles les plus masculines et que la féminisation de certaines écoles d’ingénieurs n’a pas conduit à une réelle féminisation des apprentis de ces écoles. Dans ce contexte, il décrit avec finesse les trajectoires des femmes, sursélectionnées socialement, intégrant des univers professionnels à la fois masculins et populaires, et pour lesquelles l’accès à des postes à responsabilité constitue un enjeu déterminant.
Ce travail pionnier sur l’apprentissage ouvre donc un nouveau champ d’investigation dans le supérieur. En effet, cette étude du « décloisonnement de l’apprentissage », appréhendé ici à la fois d’un point de vue socio-historique, et dans ses effets sur les expériences des publics des écoles d’ingénieurs, mériterait d’être poursuivie dans d’autres espaces, notamment à l’université. L’apprentissage n’est plus « ce petit monde de rien du tout[1] » comme l’écrivait Gilles Moreau vingt ans plus tôt, mais il peut désormais se définir comme un espace social à part entière comme le suggère Arnaud Pierrel dans ses travaux.
- Gilles Moreau (2003), Le Monde apprenti, Paris, La Dispute, p. 265. ↑