Recension : Andreas Reckwitz, Hartmut Rosa, La Modernité tardive en crise. Qu’apporte la théorie de la société ? (2024, Éditions de la MSH)
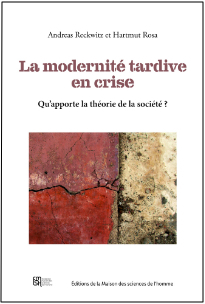
Andreas Reckwitz, Hartmut Rosa (2024), La Modernité tardive en crise. Qu’apporte la théorie de la société ?, Paris, Éditions de la MSH, 240 p.
Recension version post-print par
Arnaud Esquerre
arnaud.esquerre@ehess.fr
Directeur de recherche, sociologie, CNRS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, UMR 8156) ; IRIS, Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Sud, 5 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers, France
Pourquoi produire une théorie de la société est-elle la tâche principale de la sociologie ? Telle est la question à laquelle deux sociologues allemands, Andreas Reckwitz et Hartmunt Rosa, répondent dans un ouvrage stimulant, La Modernité tardive en crise, qu’ils signent ensemble. Ils y expliquent, tout d’abord, ce qui les unit dans une introduction commune, exposent ensuite chacun leur conception de la théorie de la société, enfin débattent en compagnie de Martin Bauer.
Cet ouvrage prend parti au sein d’une sociologie allemande actuellement en tension entre deux pôles[1]. Le premier, investi dans la Deutsche Gesellschaft für Soziologie (Société allemande de sociologie, DGS), défend une position critique en s’appuyant sur des méthodes qualitatives, dans un dialogue interdisciplinaire avec des disciplines comme l’histoire et la philosophie. Le second, organisé institutionnellement depuis 2017 autour d’une nouvelle association professionnelle, l’Akademie für Soziologie (Académie de sociologie, AS), met davantage en avant des méthodes quantitatives, prenant modèle sur les sciences de la nature, et privilégie le conseil, pour des politiques ou des entreprises. Andreas Reckwitz et Hartmunt Rosa sont des figures éminentes du premier pôle.
D’emblée, dans l’« Introduction » qu’ils cosignent, les auteurs se situent contre la spécialisation empirique, principalement en langue anglaise, calquée sur les sciences de la nature, dont ils estiment qu’elle menace d’effacer la théorie en sociologie (p. 13). Ils font, en effet, le constat que la volonté de conduire des théories de la société « a spectaculairement déserté les instituts sociologiques états-uniens et britanniques » depuis le début des années 2000 (p. 12). Or, à contrecourant des évolutions impulsées à la sociologie par les États-Unis depuis vingt-cinq ans, les deux auteurs soutiennent que l’objectif premier de la sociologie doit être d’élaborer une théorie de la société et, par conséquent, une théorie de la modernité, renouvelant par-là une tradition présente en Allemagne ainsi qu’en France, où il y a un intérêt d’un public au-delà des collègues de la discipline pour des analyses globales de la situation sociale. Chacun des auteurs détaille ensuite sa manière d’atteindre un tel objectif.
Dans une première partie (« La théorie de la société considérée comme un outil »), Andreas Reckwitz distingue, de manière éclairante, la théorie du social (Sozialtheorie) et la théorie de la société (Gesellschaftstheorie) (p. 20). La théorie du social se demande : « Qu’est-ce que le social ? » et « Sous quels aspects peut-on l’analyser ? ». Elle développe des concepts fondamentaux d’analyse sociologique, tels que ceux d’action, de communication, de rôle, d’institution, de pouvoir, etc. Andreas Reckwitz cite, en exemples, Les Règles de la méthode sociologique d’Émile Durkheim, Les Systèmes sociaux de Niklas Luhmann, La Constitution de la société d’Anthony Giddens, ou encore Changer de société. Refaire de la sociologie de Bruno Latour. Cette théorie du social se présente comme un vocabulaire universellement valable.
La théorie de la société, elle, pose comme questions : « Quelles sont les caractéristiques structurelles de la société, et en particulier des sociétés modernes ? » et « Quels sont les concepts qui permettent de les étudier ? ». Elle formule des hypothèses fondamentales sur les structures, les phénomènes et les mécanismes qui se sont constitués au cours de l’histoire et qui concernent l’ensemble de la société, et elle prend la forme d’une théorie du capitalisme, de l’esthétisation, etc. Andreas Reckwitz donne, cette fois, comme exemples, entre autres, Le Capital de Karl Marx et La Distinction de Pierre Bourdieu. La théorie de la société, interdisciplinaire et requérant plus particulièrement l’histoire, s’élabore en s’appuyant sur des recherches empiriques existantes, mais doit être capable d’en impulser de nouvelles. Elle se rapporte toujours à des situations historiques contingentes.
Théorie du social et théorie de la société ayant été différenciées, Andreas Reckwitz défend pour sa part une théorie de la pratique comme théorie du social, visant à dépasser trois dualismes courants : entre une théorie de l’action (individualisme) et une théorie de l’ordre (collectivisme), entre le matérialisme et le culturalisme, entre une micro-théorie centrée sur les situations et une macro-théorie centrée sur les structures (p. 41). Puis il synthétise ce qui caractérise, d’après lui, la société moderne à partir de trois mécanismes : un processus dialectique, a priori sans fin, d’ouverture et de fermeture de la contingence du social ; un conflit entre une logique sociale du général et une logique sociale du particulier ; et un « régime temporel de la nouveauté radical, dont le revers est une dynamique sociale de perte et une hybridation temporelle » (p. 54). Dans cette perspective, la modernité n’est pas un processus linéaire, mais le déroulement d’une contradiction et d’un conflit permanent entre rationalisme et romantisme. Cette modernité peut être découpée en trois périodes : bourgeoise, industrielle et tardive, chacune pouvant être caractérisée spécifiquement par son économie, sa structure spatiale et sociale, une forme d’État, une technique et une culture prédominantes, un type de rapport à la contingence, à la nouveauté et à la perte (résumés dans un tableau synoptique p. 91).
Dans une deuxième partie (« Best account. Esquisse d’une théorie systématique de la société moderne »), Hartmunt Rosa met l’accent sur l’auto-interprétation et considère qu’« être capable de transformer les concepts fondamentaux au moyen desquels la société se décrit et s’interprète, c’est pouvoir transformer la réalité sociale elle-même » (p. 125). S’inscrivant dans le sillage de Charles Taylor, il milite pour une démarche marquée par une recherche de systématisation et conçoit le principe de la modernité comme un processus. À revers d’analyses portant sur les structures de classes comme s’il s’agissait d’une matière morte, il propose un principe dynamique susceptible d’expliquer les transformations et qui se transforme lui-même en permanence. Ce principe, qui a fait connaître Hartmunt Rosa, est l’accélération. La modernité est, d’après lui, une formation qui ne peut se stabiliser que de manière dynamique, et qui a besoin de croissance, d’accélération et d’innovation pour se maintenir dans sa structure.
Dialoguant avec les deux sociologues dans une troisième partie (« Modernité et critique »), Martin Bauer rend saillante leur principale différence dans leur rapport à la causalité. D’un côté, Andreas Reckwitz établit une succession chronologique entre modernité bourgeoise, modernité industrielle et modernité tardive sans livrer d’explication causale et en soulignant le poids de la contingence. De l’autre, Hartmunt Rosa propose d’expliquer l’histoire de la modernité par un mécanisme fondamental de stabilisation dynamique (p. 206).
Dans un article publié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur la situation de la sociologie française, Claude Lévi-Strauss estimait que « l’échec de Lévy-Bruhl mettra sans aucun doute en garde la sociologie française contre les dangers des théories générales » et ajoutait, imprudemment, que « l’âge des constructions dogmatiques semble définitivement révolu[2] ». En dépit de leurs limites, les théories générales de la société sont, comme le plaident Andreas Reckwitz et Hartmunt Rosa de manière convaincante, nécessaires en ce qu’elles proposent une auto-compréhension de la société.
Ces théories de la société sont, cependant, dans une situation paradoxale. Comme le soulignent Andreas Reckwitz et Hartmunt Rosa, réaliser des enquêtes de plus en plus spécialisées, comme c’est la tendance dans les revues de sociologie notamment états-uniennes, ne permet pas d’élaborer des théories de la société. Mais ces dernières courent-elles véritablement « le danger de disparaître complètement » (p. 13) ? Les études sur la réception des travaux sociologiques (Andrew Abbott et Étienne Ollion[3], Yves Gingras et Mahdi Khelfaoui[4]) montrent que ce qui circule entre les différentes sociologies nationales, ce sont les propositions théoriques, qu’il s’agisse de théorie de la société ou de théorie du social, pour reprendre la distinction proposée par Andreas Reckwitz. Les enquêtes empiriques sans proposition théorique générale sont lues localement et n’ont guère de portée hors de la spécialisation sociologique dans laquelle elles s’insèrent. En revanche, elles utilisent, bien souvent, des propositions théoriques élaborées ailleurs, pour les critiquer, voir les défaire, parce que celles-ci sont contredites par tel cas, mais aussi pour les étendre ou les compléter en tirant parti d’une étude de tel autre cas. L’articulation entre théorie de la société et enquête empirique est plus complexe et ambivalente que l’opposition dessinée dans leur introduction par Andreas Reckwitz et Hartmunt Rosa.
Il manque d’ailleurs deux oppositions à leurs propos. La première est celle entre deux théories de la société. Même si Andreas Reckwitz signale que certaines théories comme celle de Karl Marx sont closes sur elles-mêmes et incompatibles avec d’autres, et qu’il met en garde contre le bellicisme intellectuel visant à éliminer une théorie au profit d’une autre (p. 112), les théories de la société peuvent s’élaborer et former leur cohérence en s’opposant l’une à une autre, comme la théorie de l’acteur-réseau de Bruno Latour s’est largement construite en prenant le contrepied de la sociologique critique de Pierre Bourdieu. Se pose dès lors la question de savoir comment elles peuvent, d’une part, donner naissance à de nouvelles théories cohérentes, d’autre part, être cumulatives. La seconde est l’opposition entre les disciplines : la théorie sociologique s’oppose à d’autres théories générales, au premier rang desquelles celles venant de l’économie, cette discipline en position de domination au sein des sciences humaines et sociales[5].
À cela s’ajoute le fait que les théories de la société sont, généralement, déployées dans des livres, tandis que le format privilégié des enquêtes empirique est celui de l’article. Des sociologues[6] font désormais le constat, aux États-Unis, que le processus de relecture des revues, le Revise-and-Resubmits, étouffe la créativité théorique et empêche l’élaboration de nouveaux concepts, car un auteur doit se conformer à des évaluations généralement divergentes, voire contradictoires, ce qui entraîne la publication de résultats sans relief[7]. Ces auteurs d’articles puisent les propositions théoriques dans des livres, format qui permet de développer et de mieux asseoir des propositions théoriques, et qui autorise aussi davantage d’audaces.
Que la sociologie prenne la forme de théories de la société ou d’enquêtes empiriques, elle ne peut échapper, toutefois, pour continuer à exister, à la question de son utilité. Les enquêtes empiriques permettent d’offrir, de manière circonscrite, des conseils pour améliorer ou des critiques pour modifier les dispositifs sociaux étudiés. Une théorie de la société a pour visée de s’appliquer, c’est une tautologie, à l’échelle d’une société, ouvrant la question d’une transformation de ses normes. Elle peut « indiquer des possibilités d’intervention par le moyen de l’analyse » (p. 231), nous dit Andreas Reckwitz, qui revendique un « normativisme minimal » (p. 235), tandis que Hartmunt Rosa assume un normativisme plus affirmé, animé par « une sorte d’idée de salut, l’utopie d’un monde entièrement résonant » (p. 236). Mais, quel que soit le choix normatif, il reste à dessiner de manière plus précise comment s’opèrent ces passages de la théorie à l’action.
- Christian Schmidt-Wellenburg, Andreas Schmitz (2022), « Divorce à l’allemande. Luttes symboliques et tensions institutionnelles dans la sociologie allemande contemporaine », Actes de la recherche en sciences sociales, no 243-244, p. 110-123. ↑
- Claude Lévi-Strauss (2019), « La sociologie française (1945) » Anthropologie Structurale Zéro, Paris, Seuil, p. 98. ↑
- Andrew Abbott, Étienne Ollion (2016), « French Connections. The Reception of French Sociologists in the USA (1970-2012) », European Journal of Sociology, vol. 57, no 2, p. 331-372. ↑
- Yves Gingras, Mahdi Khelfaoui (2025), « The Relative (In)visibility of Sociologists in the French, American, British, and German National Fields (1970-2018) », Social Science Information, vol. 64, no 1, p. 32-59. ↑
- Marion Fourcade, Étienne Ollion, Yann Algan (2015), « The Superiority of Economists », Journal of Economic Perspectives, vol. 29, no 1, p. 89-114. ↑
- Tels que Bruce G. Carruthers, Neil Fliegstein, Stefan Timmermans, Christine L. Williams. ↑
- David Stark (dir.) (2024), Practicing Sociology. Tacit Knowledge for the Social Scientific Craft, New York, Columbia University Press. ↑