Recension : Anatole Le Bras, Aliénés. Une histoire sociale de la folie au XIXe siècle (2024, Cnrs Éditions)
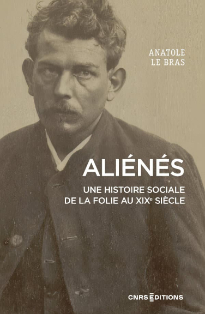
Anatole Le Bras (2024), Aliénés. Une histoire sociale de la folie au XIXe siècle, Paris, Cnrs Éditions, 400 p.
Recension version post-print par
Enzo Bessega
enzobessega@uchicago.edu
Doctorant en sociologie, Department of Sociology, University of Chicago, 1126 East 59th Street, Chicago, IL 60637, United States
Anatole Le Bras resserre l’étude de la folie sur la « condition aliénée[1] », une approche par les malades, moins étudiés que les institutions et traitements psychiatriques. Ce travail issu de sa thèse s’appuie sur les registres d’entrée et les dossiers d’internement de l’asile de Quimper, l’hospice de Morlaix et l’asile de Ville-Évrard, auxquels s’ajoutent les correspondances, la littérature médicale, des rapports administratifs ainsi que des données quantitatives. Au cœur du livre, la loi du 30 juin 1838, qui impose la présence d’un asile dans chaque département, pour le « placement volontaire » (décidé par la famille ou un tiers sur décision médicale) ou le « placement d’office » (ordonné par un préfet ou un maire). Cette loi amplifie la croissance de ces institutions – qui passent de 10 000 en 1838 à plus de 70 000 en 1914 – et tend à uniformiser l’expérience des malades, en dépit d’inégalités, alors même que les médecins aliénistes ne croient pas à la guérison de la folie. Anatole Le Bras présente l’asile comme le succès d’une institution prioritairement sécuritaire, secondairement médicale, dont il réalise une sociographie fine, attentive à la classe et au genre.
Il montre d’abord comment l’asile rend inopérante une forme antérieure de gestion de la folie à domicile, la séquestration familiale. Alors beaucoup pratiquée en milieu rural, elle s’exerce sur des individus fortement dépendants de leurs liens familiaux, quand surveillance et gardiennage ne suffisent plus, et est informellement couverte par le voisinage. Contorsionnés à vie après avoir passé des années – parfois des décennies – recroquevillés sur de la paille parmi le bétail, ces aliénés menacent la respectabilité familiale. Les scandales médiatiques autour des séquestrations conduisent à des procès où sont condamnés, avec une grande clémence quand l’aliénation mentale est avérée, les vestiges d’une « barbarie rurale ». Chacune de ces révélations est l’occasion pour les aliénistes de légitimer les bienfaits de l’asile contre l’arbitraire familial au profit d’un élargissement de l’intervention étatique et du droit.
La hausse des internements ne manque pas de poser la question des causes d’une épidémie de folie au cours du xixe siècle. L’auteur fait un premier détour par l’origine sociale des internés et en conclut qu’ils appartiennent aux franges âgées de classes populaires hétérogènes. Est-ce alors le mariage qui protège de la folie, ou bien la vie rurale, comme le défendent certains médecins ? L’étude de ces topoï montre que le mariage est surtout plus accessible pour ceux avec des troubles légers – la folie conditionnant le célibat – et écourte la durée d’internement. Les célibataires ne sont pas significativement plus représentés. De même, la ville ne cause pas la folie : « il est plus convaincant d’expliquer la surreprésentation urbaine par les effets de la proximité des institutions de soin, ainsi que par les modalités du contrôle social et du maintien de l’ordre » (p. 91). L’auteur suggère donc que l’épidémie de folie provient essentiellement de la loi de 1838 et du déploiement asilaire, qui rendent visibles, par leur identification, les fous. Pour autant, les familles ne requièrent pas l’internement immédiat après une crise de démence. Au contraire, c’est la solution en dernier recours quand la famille ne peut plus assurer le maintien à domicile, privilégiée par le concours du maire, des préfets ou des gendarmes. Ces fonctions locales forment un réseau sécuritaire qui veille au maintien de l’ordre contre la folie dans la place[2].
Le livre creuse l’usage polysémique de l’« aliénation mentale » dans la nosographie. Sont identifiés comme fous les déviants dangereux, au sens large et imprécis de Michel Foucault[3], c’est-à-dire autant les vagabonds, les alcooliques, les violents et les déments que les incendiaires. Cependant, « l’aliéné n’est pas seulement du côté de la transgression de la norme » (p. 135). Par cette judicieuse remarque, Anatole Le Bras rapproche les fous des normaux : si la folie a pu être décrite comme le mal du siècle, ce n’est pas parce qu’elle était incarnée par de pures altérités déviantes mais vue comme le résultat de « causes morales » (p. 137) qui guettent même une personne des plus raisonnables, à la suite d’une injustice, d’un chagrin, d’un incendie, bref de bouleversements soudains. L’auteur affine donc la distinction entre déviance et normalité avec une thèse stimulante : l’incapacité à tenir l’idéal de normalité genré auxquels les individus aspirent a pour conséquence tragique non anticipée qu’ils soient désignés comme fous. La « folie [des femmes] résulte plus souvent d’une aspiration déçue à un idéal domestique et familial que de son rejet » (p. 161), tandis que pour les hommes « l’exacerbation pathologique de la virilité » (p. 166) assimile à la folie, cette incapacité à tenir son rang d’homme dans des limites de la virilité acceptable, à savoir dominer son épouse sans commettre de violences conjugales répétées ou boire avec assurance sans devenir alcoolique. Il faut réussir à endosser ces rôles genrés contradictoires en respectant un équilibre pulsionnel, sinon l’asile intervient pour réprimer leur exacerbation.
Le séjour à l’asile correspond à une « capture institutionnelle » (p. 169) qui socialise les habitus à la contrainte de l’internement. Dès l’entrée, « en fonction du type de maladie, du genre et de l’insertion familiale » (p. 170), le sort des malades et la durée de leur internement sont déjà plus ou moins déterminés. L’alcoolisme touche particulièrement les hommes et facilite leur sortie car il s’agit d’un délire passager. En outre, ces derniers possèdent un pouvoir économique considérable qui requiert davantage leur présence parmi les proches. À l’inverse, les femmes sont atteintes par les troubles les plus invalidants, comme la démence, sont plus âgées et moins réclamées en raison de leur moindre pouvoir domestique. Imprégné des travaux d’Erving Goffman, Anatole Le Bras insiste sur l’« asilisation » que produit la fréquentation de l’asile, phénomène d’habituation à l’institution totale qui rend inaptes les aliénés à un retour dehors. Alors qu’il ne guérit qu’une infime partie des internés (environ 7 %), l’asile cause des effets iatrogènes (p. 179) qui l’exposent rapidement à des critiques.
L’objectif des asiles consistait à rompre les liens familiaux néfastes pour privilégier l’isolement, censé être un facteur de guérison. Aliénés montre l’inverse : les liens familiaux sont cruciaux pour motiver l’internement, mais aussi pour favoriser le retour au domicile parce que le malade est réclamé, ce qui incline favorablement les médecins à le réintégrer. De fait, les célibataires et les femmes âgées sont internés plus longuement. La correspondance, les permissions et les visites participent au maintien des liens familiaux, mais leurs disponibilités inégales peuvent donner l’impression, à tort, que ces malades sont abandonnés. L’auteur rappelle que la correspondance, souvent impossible dans les familles illettrées les plus populaires, est contrôlée de près par les médecins et que les visites sont très onéreuses.
Deux mesures étiolent les droits des aliénés : l’internement « [prive] de la jouissance de ses droits civils et de l’administration de ses biens » et l’interdiction « permet de placer un aliéné sous la tutelle d’un individu désigné par le conseil de famille » (p. 226). L’auteur décrit des processus d’incapacitation (perte de droits civiques) et de dépossession de soi matérielle et symbolique chez les personnes avec des troubles cognitifs majeurs, facteurs de mort civile et de pauvreté. Toutefois, la toute-puissance n’est pas immédiatement octroyée aux familles dont les abus sont aussi dénoncés ; il s’agit plutôt d’un gel des biens avec l’internement qu’elles ne peuvent lever qu’en recourant à l’interdiction. En outre, la demande d’interdiction est longue et surtout activée dans le cas des familles aisées ou des classes populaires stables vis-à-vis d’une personne avec du pouvoir. Elle reste encore une « procédure peu médicalisée » (p. 246) lors de laquelle le diagnostic est établi par la famille et la justice. L’interdiction peut radicaliser la mise sous tutelle et tendre vers la mort sociale de l’interné mais « s’inscrit dans la continuité [des] modes informels de mise sous tutelle [comme la séquestration] » (p. 254) où les individus continuent à vivre avec leur famille. Ces deux mesures s’additionnent ou sont choisies indépendamment, allant du contrôle matériel familial (interdiction sans internement) au contrôle matériel et symbolique famille-asile (internement et interdiction, avec incapacitation et dépossession de soi).
Les internés ne protestent pas collectivement mais écrivent en revanche beaucoup. Ceux qui ne souffrent pas d’illettrisme peuvent résister ainsi mais c’est à double tranchant car ces écrits constituent également une « précieuse valeur de preuve » (p. 275) judiciaire ou médicale utilisée contre eux comme symptôme de leur folie. Par conséquent, les écrits des aliénés, loin de représenter un fragment fulgurant de vérité sur l’expérience de la folie, sont médiés par le contrôle de l’asile. En d’autres termes, ils suivent les règles de l’institution, qui les surveille, y compris quand ils sont dirigés contre elle à des fins de manipulation ou comme gages de bonne conduite. Pour espérer recouvrer sa liberté, l’aliéné peut adresser des suppliques dans lesquels il doit se raconter, reconnaître sa maladie, mettre en avant ses progrès pour la surmonter et faire preuve de patience. S’il ne parvient pas à convaincre les médecins par cette voie, il peut se faire réclamer par la famille. La solution, plus risquée et hasardeuse, mais qui gagne en importance à la fin du xixe siècle avec les discours anti-aliénistes, consiste à critiquer les conditions de son internement, en faisant appel à la loi, ou à les médiatiser.
Le dernier chapitre s’interroge sur la sortie de l’asile. La capture institutionnelle déclenche surtout un mouvement d’« attraction asilaire » (p. 316) avec entrées et sorties régulières, notamment pour les malades temporaires, comme les alcooliques. Nul besoin d’obtenir la guérison pour sortir, mais il faut « réencastrer » (p. 317) l’aliéné dans une communauté « qui garantira son innocuité sociale et assumera la responsabilité de ses actes » (p. 319), c’est-à-dire renverser le processus de désaffiliation aggravé par l’internement dû à l’asilisation, l’incapacitation, la dépossession de soi et l’éloignement géographique.
Anatole Le Bras lutte contre une histoire sociale qui n’étudierait que les traces les plus saillantes des aliénés et fait un pas de côté pour les saisir en dehors de l’asile. Un grand soin est apporté à ne pas négliger le rôle des familles, certes extérieures mais centrales dans l’internement, les réintégrations et les récidives. Ce livre important donne une consistance historique aux apports d’Erving Goffman par l’analyse du processus de socialisation à une forme nouvelle d’institution totale. Toutefois, une discussion avec certains travaux récents de sociologie, comme ceux de Muriel Darmon[4] autour de la notion de carrière, aurait permis de dégager des phases d’internement, notamment eu égard aux nombreux allers-retours des malades. L’ouvrage propose une thèse claire et méticuleuse du succès de la folie par celui de l’institution asilaire, qui invite à se demander plus généralement comment l’apparition d’institutions contribue à faire exister les maladies qu’elles sont a posteriori censées soigner. Ce renversement intéressant de la causalité ne doit néanmoins pas occulter l’émergence d’un besoin social de traitement des troubles psychiques qui, au-delà des enjeux de contrôle social, témoigne d’une transformation des sensibilités vis-à-vis de la cruauté, laquelle mérite de continuer à être explorée.
- Expression de Pap Ndiaye (2008), La Condition noire. Essai sur une minorité française, Paris, Calmann-Lévy, pour désigner une population minoritaire. ↑
- Erving Goffman (1969), « The Insanity of Place », Psychiatry. Journal for the Study of Interpersonal Processes, vol. 32, no 4, p. 357‑388. ↑
- Michel Foucault (1972), Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard. ↑
- Muriel Darmon (2008), Devenir anorexique. Une approche sociologique, Paris, La Découverte. ↑