Déviance
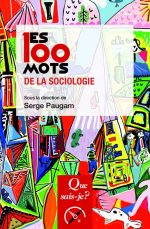
Laurent Mucchielli, « Déviance », in Paugam Serge (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que Sais-Je ? », 2e édition, 2018, p. 63.
Consacrée par Merton et Parsons, la notion de déviance apparaît d’abord dans la sociologie américaine des années 1950. Elle élargit alors le domaine classique des recherches sur la délinquance développé dans l’entre-deux-guerres par les sociologues de « l’École de Chicago » et dominé par la théorie de la désorganisation sociale. Ensuite, dans les années 1960, elle est transformée et théorisée de façon décisive par des auteurs comme Lemert, Matza, Becker, Goffman et, plus largement, ce que l’on appellera la « seconde École de Chicago ».
La déviance se définit comme l’envers de la norme qu’elle transgresse. Pour exister comme question sociale, la déviance suppose la réunion de trois éléments : une norme, une transgression de cette norme et une « réaction sociale » à la transgression de cette norme. Chacun de ces trois éléments constitue un domaine de recherche sociologique.
La constante évolution historique des normes détermine du même coup les contours de la déviance. Certains comportements jadis criminalisés ou stigmatisés ne le sont plus (l’homosexualité). D’autres le deviennent (l’évolution des normes en matière de santé et de sécurité). Ces évolutions sont l’objet de conflits entre groupes sociaux, groupes politiques, intérêts commerciaux.
Ce constat de la primauté et de l’instabilité des normes renouvelle ensuite le débat théorique sur la transgression, longtemps parasité par les modèles de type biologiques naturalisant l’opposition entre le normal et le pathologique. L’attention se porte alors sur les déterminants psychosociaux de l’adhésion aux normes, sur les processus de socialisation et de conformisme social.
Enfin, la transgression d’une norme n’a pas d’existence sociale si nul ne la remarque et ne la stigmatise. C’est le champ de la sociologie de la réaction sociale. Comment et pourquoi les déviances sont-elles repérées, qualifiées, dénoncées, poursuivies ? Quels sont les acteurs de ces réactions sociales ? Comment évoluent-elles ?
Pour découvrir les 99 autres « mots de la sociologie »…
> Retrouver le livre sur le site des Presses universitaires de France
https://www.puf.com/content/Les_100_mots_de_la_sociologie
> Et sur la plate-forme Cairn.info (édition 2010)
https://www.cairn.info/les-100-mots-de-la-sociologie–9782130574057.htm