29. La culture est-elle en danger ?
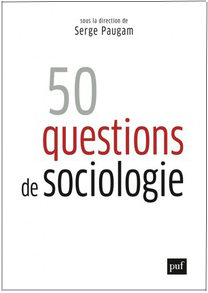
Julien Duval, « 29. La culture est-elle en danger? », in Paugam Serge (dir.), 50 questions de sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 2020, p. 293.
L’idée selon laquelle la culture serait en danger, en crise ou en déclin est un lieu commun que les milieux cultivés et les professionnels de la culture agitent à toutes les époques : un bon mot veut que le diagnostic de la « crise de l’édition » soit aussi ancien que l’édition et il est compréhensible que, dans une formation sociale donnée, les plus âgés soient portés à assimiler à de l’inculture la culture des générations plus jeunes dès lors qu’elle diffère, même légèrement, de la leur. Au-delà de la permanence du diagnostic, il est permis de s’interroger sur ce que peut recouvrir aujourd’hui l’idée d’une « crise de la culture ».
Qu’est-ce que la culture ?
Parlant de « culture », on prend rarement le temps de préciser ce qu’on entend par ce mot pourtant très polysémique et presque toujours chargé de présupposés et de jugements de valeur tacites. Ainsi, si « la culture » est un sujet d’inquiétude, c’est qu’elle est censée être une production humaine de grande valeur. De fait, dans beaucoup de groupes et de sociétés, elle est regardée comme un bien précieux qui se transmet d’une génération à l’autre, parfois par le truchement d’institutions comme l’école. Des anthropologues rapportent la célébration qui l’entoure au fait que ses œuvres – et particulièrement les œuvres artistiques – seraient les traces les plus durables des civilisations. S’il faut relever la valeur sociale accordée à la culture, il faut aussi souligner ce que signifie, dans la vie sociale, l’affirmation de cette valeur. C’est, par exemple, se poser en personne de culture que d’avoir conscience du prix de la culture. Inversement, ignorer ce prix, c’est s’exposer à se voir qualifié du terme de « barbare » dont les anciens Grecs affublaient les étrangers, c’est-à-dire ceux qui ignoraient leur culture.
Pierre Bourdieu (1979), une référence importante aujourd’hui en « sociologie de la culture », soulignait le rôle quasi-religieux que joue la culture dans notre société et qu’illustre par exemple l’atmosphère proche du recueillement dans les musées. Il montrait aussi que le culte de la culture et de l’art n’a pas partout la même intensité. Dans notre société, il culmine au sein des groupes les mieux dotés en capital culturel, ceux qui prennent part à la transmission et à la création culturelles (artistes, enseignants…). La discussion, à un niveau international, des analyses de P. Bourdieu a, elle, suggéré que le culte de la culture est spécialement prononcé en France. Les plaisirs esthétiques, avec le raffinement et l’élévation qui leur sont associés, participent de l’héritage de la « société de cour » qui a durablement – et au-delà des milieux aristocratiques – marqué les styles de vie dans ce pays (Elias, 1973) qui est aussi le premier pays à s’être doté d’un « Ministère de la Culture ».
Émile Durkheim (1938), pour sa part, regardait comme une particularité nationale l’importance accordée en France à l’enseignement d’une culture littéraire dépourvue d’utilité pratique et à forte dimension esthétique. Dans une conception aristocratique remontant à la Renaissance, l’école a longtemps privilégié, notamment par rapport à une culture scientifique ou technique, la transmission d’une culture « humaniste » centrée sur l’apprentissage de la littérature et de la langue latine dans laquelle les grands auteurs étaient censés avoir exprimé une fois pour toutes des vérités éternelles. Émile Durkheim raisonnait dans un contexte où la prééminence des « humanités » commençait à être discutée. C’est aussi le fondateur de la sociologie qui s’exprimait : étant elle-même une production culturelle, la sociologie ne peut pas être neutre dans ces débats ; on a d’ailleurs parfois vu en elle une « troisième culture ».
Le terme de « culture » est de fait souvent employé dans un sens restrictif – et normatif – correspondant à la seule culture académique. Pourtant, bien des réalisations humaines étrangères à cette dernière et issues de sociétés non occidentales ou des classes « populaires » sont des produits de la culture humaine. Elles se prêtent d’ailleurs parfois, autant que l’art grec ou les pièces de Shakespeare, à la contemplation esthétique et intellectuelle. La conception traditionnelle de la culture se présente comme universelle et tolérante mais elle rejette dans une sorte de non-culture, sinon dans la barbarie, une part considérable de l’humanité. Elle a constitué de ce point de vue un instrument de domination dans le cadre du colonialisme européen ou des relations de classe. Les sciences sociales ont joué un rôle important dans cette dénonciation mais leurs analyses s’exposent à une contradiction : si la conception traditionnelle de la culture est ethnocentrique, il pourrait l’être aussi d’inclure dans l’univers de la culture des produits fondamentalement extérieurs à l’appareil culturel académique occidental dont notre conception de la culture reste dépendante. Pierre Bourdieu faisait ainsi valoir que l’expression de « culture populaire » qui « réhabilite » les produits qu’elle désigne – et les groupes qui les consomment – fait écran à la compréhension de ces derniers. Quoi qu’il en soit, on comprend la nécessité, lorsqu’on parle de « culture », de préciser dans quel sens le mot doit s’entendre.
Consommations et pratiques culturelles
Les enquêtes sur les pratiques culturelles qui se sont développées après la Seconde Guerre mondiale aident à connaître les évolutions des dernières décennies. En France, le ministère de la Culture mène une enquête de ce type à intervalles réguliers depuis 1973, les derniers résultats publiés datant de 2008.
Les questions qui ont été posées, sous la même forme, lors des éditions successives (Donnat, 2011), sont peu nombreuses mais la plupart ne font apparaître sur 35 ans que de faibles variations, ce qui suggère une forte inertie des comportements étudiés. Les proportions de Français s’étant rendus lors de l’année écoulée au musée ou à une exposition (autour de 30 %), à une pièce de théâtre (autour de 15 %) ou à un concert de musique classique (autour de 8 %) sont assez stables. Seuls des indicateurs comme les pourcentages de répondants regardant la télévision ou écoutant de la musique tous les jours ou presque ont cru : ils sont respectivement passés, entre 1973 et 2008, de 65 % à 87 % et de 9 % à 34 %. Inversement, la lecture intensive s’est raréfiée : la lecture d’un quotidien tous les jours ou presque concernait 55 % de la population en 1973, mais seulement 29 % en 2008 et la part des Français déclarant lire plus de vingt livres par an est tombée de 28 % à 16 %. Chaque génération compte moins de gros lecteurs que la précédente. L’érosion a fini par toucher les catégories qui lisaient le plus, comme les couches diplômées et les femmes.
Contemporain d’un important élargissement de l’accès à l’enseignement, ce recul peut étonner. Il concerne une pratique (la lecture) qui, inaccessible au plus grand nombre pendant des siècles, a valeur de symbole d’un recul plus général de la culture savante, dont il existe d’autres signes. Des travaux attirent l’attention sur le vieillissement du public de formes culturelles dotées d’une forte légitimité critique (musique contemporaine, cinéma d’art et essai…). Dominique Pasquier (2005) montre que, dans des lycées parisiens des quartiers bourgeois, la culture la plus légitime s’accompagne plus souvent que par le passé d’une bonne connaissance de productions culturelles de grande diffusion. Ses conclusions convergent avec la littérature sur l’éclectisme culturel croissant des classes supérieures (Peterson, 2004).
Un point faible de cette thèse est que ces classes n’ont sans doute jamais limité leurs consommations culturelles à une culture d’élite. Leur éclectisme n’est pas une nouveauté et l’hypothèse de sa progression est difficile à vérifier : les données se prêtant à des comparaisons dans le temps sont rares. De plus, le périmètre de la « culture légitime » change selon les époques. Enfin, les enquêtes statistiques n’enregistrent que les consommations et pas leurs modalités – qui constituent pourtant une dimension essentielle de la distinction culturelle. La prudence s’impose également au sujet des évolutions statistiques car les indicateurs restent grossiers. Les chiffres ne portent que sur la quantité de livres lus, et pas sur leur qualité, et aucun indicateur n’est absolument comparable à deux dates différentes : les journaux et les livres ne peuvent plus avoir aujourd’hui la même place qu’il y a trente ans, ne serait-ce qu’en raison de la multiplication des écrans – sur lesquels d’ailleurs on lit parfois beaucoup. Certains chercheurs ajoutent que les enquêtes n’enregistrent que des déclarations : la baisse enregistrée pourrait aussi tenir à une moindre tendance des répondants à surestimer le nombre de livres qu’ils lisent, parce que le livre a perdu en centralité et en prestige.
Si elle est donc difficile à étayer de façon indubitable, l’hypothèse d’un déclin, dans tous les groupes sociaux, de la culture savante traditionnelle ou de l’appétence pour les biens culturels les plus distinctifs paraît en tout cas plus plausible que l’hypothèse inverse.
Prescripteurs et producteurs
Des éléments peuvent par ailleurs être réunis au sujet des dynamiques affectant l’offre et la prescription culturelle. L’institution scolaire reste centrale dans la transmission d’une culture légitime et dans la formation de consommateurs culturels. Mais le lien historique qui l’unissait à la culture humaniste s’atténue. La série littéraire du baccalauréat ne concerne plus qu’une minorité de bacheliers (9 %). Aujourd’hui, c’est la série scientifique qui paraît la plus prisée. Les humanités n’ont pas pour autant perdu toute aura. En témoignent par exemple la place que conserve la littérature à l’école, les mobilisations pour la « sauvegarde » du latin ou les références appuyées que les programmes scolaires continuent de faire à une « culture humaniste » toujours créditée dans des textes officiels d’un rôle irremplaçable dans « la formation du jugement, du goût et de la sensibilité ».
Le déclin relatif des humanités s’observe aussi dans l’enseignement supérieur. Des cultures scientifiques mais aussi, par exemple, des cultures techniques, économiques ou managériales (Le Gall & Soulié, 2008 ; Savage, 2010) ont monté en puissance à l’Université – et pas seulement en France. Incarnation typique d’une conception aristocratique et désintéressée du savoir, les humanités classiques se prêtent particulièrement à la critique d’un enseignement coupé du monde productif. Leur recul, s’il s’accélère dans le contexte des réformes actuelles des universités, remonte aux premières décennies du xxe siècle. Son impact sur les pratiques culturelles est impossible à mesurer, mais les enquêtes statistiques font toujours apparaître que le goût pour la culture savante, intellectuelle ou d’avant-garde, culmine chez les diplômés issus des filières à dominante littéraire.
La politique culturelle (Dubois, 2012) doit aussi retenir l’attention. L’idée que la culture n’est pas un « bien économique comme les autres », qu’elle possède une valeur irréductible aux profits économiques qu’elle engendre, est prégnante en France, mais a été beaucoup combattue depuis les années 1990 dans les négociations internationales au profit de conceptions plus mercantiles. Des évolutions se sont également produites au niveau national. Tourné à sa création vers la promotion d’une culture très légitime, le ministère de la Culture a élargi son périmètre dans les années 1980. Peinant à attirer un large public vers la haute culture et prenant acte de la dénonciation de l’étroitesse de la définition académique et normative de la culture, il s’est ouvert à une culture et des arts plus « populaires ». Il a aussi pris des distances avec des conceptions sacralisantes de la culture comme chose sans prix et sans coût, en affirmant la possibilité de poursuivre simultanément des finalités économiques et culturelles.
Il faut, pour finir, évoquer les transformations des secteurs culturels eux-mêmes. Beaucoup ont connu, lors des 30 ou 40 dernières années, des processus de concentration économiques au profit de grands groupes qui attendent surtout de leurs investissements des retours financiers rapides. D’un point de vue économique, les secteurs culturels sont loin d’être tous en crise. Par exemple, l’érosion du nombre de gros lecteurs n’a pas empêché une augmentation de près de 50 % du nombre annuel de livre vendus entre 1986 et 2012. L’usage de la notion sociologique de « champ » aide à comprendre que s’est souvent produite la montée en puissance d’un pôle tourné vers une production « grand public » visant à rapporter des profits importants en un court laps de temps par une stratégie de « saturation » du marché (Thompson, 2010). Le poids accru des best sellers dans l’édition ou des blockbusters dans d’autres secteurs a pour contrepartie l’affaiblissement d’une production culturelle plus « audacieuse » ou plus expérimentale qui ne dispose pas de public préconstitué, ou à une échelle réduite. Pour cette raison, les acteurs « indépendants » dans ces secteurs peuvent s’estimer régulièrement aujourd’hui « en danger ».
Si la perspective d’un déclin de la culture savante traverse des travaux sociologiques récents, les éléments empiriques à l’appui de cette thèse invitent à la prudence. Ils autorisent au plus à dire que des conceptions de la culture héritées du passé – qui ont été caractérisés ici en faisant référence aux humanités ou à l’idée de l’œuvre sans prix – rencontrent aujourd’hui des difficultés en relation, du moins pour certaines d’entre elles, avec le « tournant néo-libéral » ou les dynamiques d’économicisation et de rationalisation. Ils montrent aussi l’intérêt que présenterait une interrogation systématique sur la notion de culture, non pas seulement dans une logique définitoire, mais aussi parce que la définition et le périmètre de la notion sont parties intégrantes des transformations de « la culture ».
Mots-clés : école/enseignement, éclectisme, pratiques culturelles, État et politiques, néolibéralisme
Voir aussi la question : 16 Comment se forment les goûts culturels aujourd’hui ? »
Bibliographie
- Bourdieu Pierre, 1979, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit.
- Donnat Olivier, 2011, « Pratiques culturelles, 1973-2008. Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales », Culture Études, no 7.
- Dubois Vincent, 2012, La Politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique (1999), Paris, Belin.
- Durkheim Émile, 2014 [1938], L’Évolution pédagogique en France, Paris, Puf.
- Élias Norbert, 1973 [1939], La Civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy.
- Le Gall Brice & Soullié Charles, 2008, « Massification, professionnalisation, réforme du gouvernement des universités et actualisation du conflit des facultés en France », in ARESER, Les Ravages de la modernisation universitaire en Europe, Paris, Syllepse, p. 173-208.
- Pasquier Dominique, 2005, Cultures lycéennes : la tyrannie de la majorité, Paris, Autrement.
- Peterson Richard, 2004, « Le passage à des goûts omnivores : notions, faits et perspectives », Sociologie et sociétés, vol. 36, no 1, p. 145-164.
- Savage Mike, 2000, Identities and Social Change in Britain since 1940. The Politics of Method, Oxford, Oxford University Press.
- Thompson John, 2010, Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty-First Century, Cambridge, Polity Press.
Pour découvrir les 50 questions de sociologie…
> Retrouvez le livre sur le site des Presses universitaires de France
https://www.puf.com/50-questions-de-sociologie
> Et sur la plate-forme Cairn.info
https://www.cairn.info/50-questions-de-sociologie–9782130820673.htm