Recension : Henri Bergeron, Patrick Castel, L’Organocène. Du changement dans les sociétés surorganisée (2024, Presses de Sciences Po)
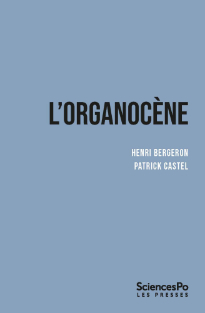
Henri Bergeron, Patrick Castel (2024), L’Organocène. Du changement dans les sociétés surorganisées, Paris, Presses de Sciences Po, 340 p.
Recension version post-print par
Pierre Robicquet
pierre.robicquet@minesparis.psl.eu
Postdoctorant dans le cadre du projet CoProExpert ; Centre de sociologie de l’innovation, Mines Paris-PSL-CNRS UMR 9217, 60 boulevard Saint-Michel, 75272 Paris cedex 06, France
L’ouvrage d’Henri Bergeron et Patrick Castel, L’Organocène, entreprend le développement d’une théorie du changement dans les « sociétés sur-organisées ». Le point de départ des deux auteurs est le suivant : d’un côté, le nombre d’organisations augmente et la pression à les transformer s’intensifie sous l’effet conjugué de la compétition économique, des injonctions managériales à l’innovation et de la nécessité de répondre à diverses crises ; de l’autre, la capacité effective des acteurs à conduire ces transformations bute sur la complexité croissante des systèmes d’action et des outils de gestion. Partant de ce constat, l’expression « organocène » permet de désigner les sociétés modernes saturées d’organisations et de « dramatiser » la complexité et l’interdépendance qui les caractérise. Elle n’invite pas à une discussion sur la nature de l’espèce humaine, mais est mobilisée comme un outil de cadrage pour esquisser une théorie « non exclusive » et « transposable » du changement, fondée sur une conception relationnelle du pouvoir.
L’ouvrage est structuré en six chapitres. Le premier dresse un panorama critique des théories du changement institutionnel. Là où les néo-institutionnalistes privilégiaient l’analyse des routines et considéraient le changement subordonné à des conditions structurelles (crises, chocs, fenêtres politiques), les auteurs montrent que les récentes approches associées à l’institutionnalisme organisationnel tendent au contraire à surestimer la capacité de quelques acteurs à bousculer les structures établies. Le succès de la notion « d’entrepreneur institutionnel » illustre ce déplacement et ces individus qui, seuls ou coalisés, sont capables de « penser à distance » les normes qui les encadrent et de convertir cette prise de conscience en action collective. Or, disent-ils, le mythe du dirigeant providentiel n’explique pas pourquoi celui-ci a pu réussir avec succès dans une organisation et échouer dans une autre. Entre ces différentes approches, Henri Bergeron et Patrick Castel identifient ainsi l’existence de schémas explicatifs unilatéraux et invitent à analyser les conditions qui rendent possible (ou empêchent) l’action transformatrice. En pointant les limites de leurs prédécesseurs, ils annoncent les grandes lignes de leur théorie : les acteurs ne déploient leurs stratégies de changement qu’au sein d’un contexte structurel donné, caractérisé par une distribution des ressources et des rapports de pouvoir établis. Sur la forme, le chapitre est également annonciateur du schéma démonstratif que les deux auteurs appliqueront tout au long de l’ouvrage, en développant chaque argument suite à la discussion des apports et des limites de travaux antérieurs. Le livre est ainsi construit en négatif, pour ce qu’il n’est pas et ce que les auteurs proposent de pallier.
Suivant cette logique, le deuxième chapitre part d’une autre critique : les théories néo-institutionnelles, les études sur le leadership ou celles encore en termes de policy frames partagent le biais suivant lequel une requalification cognitive (un cadrage, un récit, une théorisation) précède et déclenche systématiquement l’action collective. Ces travaux ont ainsi tendance à valoriser le rôle des constructions symboliques et la capacité des acteurs à redéfinir des significations pour entraîner le changement. Henri Bergeron et Patrick Castel y voient un « tropisme discursiviste » et argumentent qu’en se concentrant principalement sur les idées et les récits, ces travaux en viennent à négliger les ressorts plus concrets du pouvoir et des structures qui conditionnent le changement (et la reproduction) organisationnel(le) – comme si nommer et convaincre suffisait à transformer le réel. Sans nier l’importance des cadres cognitifs ou culturels, les auteurs y voient un excès d’idéalisme, les discours n’expliquant rien si l’on ne comprend pas qui détient le pouvoir d’agir et comment ce pouvoir s’exerce dans les structures en place. C’est précisément la tâche à laquelle ils s’attellent dans le chapitre suivant.
Le chapitre trois présente ce qu’Henri Bergeron et Patrick Castel appellent une « conception relationnelle du pouvoir ». Alors que les néo-institutionnalistes privilégient une approche du pouvoir discret et systémique et que les tenants de l’institutionnalisme organisationnel se concentrent principalement sur sa dimension épisodique et instable, les auteurs introduisent une troisième perspective centrée sur les relations entre les acteurs et héritée des travaux de Michel Crozier et Erhard Friedberg. Le pouvoir n’y est plus défini comme un attribut individuel ou un capital lié à la position dans l’espace social, mais comme le résultat d’une structure relationnelle complexe, constituée par un réseau dynamique d’échanges, d’alliances et de dépendances certes asymétriques, mais réciproques. Dans ces termes, la figure ou le comportement de l’entrepreneur sont autant déterminés par ses compétences que par la position qu’il occupe dans une structure relationnelle. Ce faisant, ils nuancent l’idée d’une domination monolithique – même les ordres sociaux les plus stables sont parcourus de transactions, de résistances, de contournements – tout en évitant de fétichiser les jeux de pouvoir locaux comme une fin en soi – ceux-ci ne prennent sens que par rapport à la structure de domination dans laquelle ils s’inscrivent. En conclusion du chapitre, Henri Bergeron et Patrick Castel établissent un lien entre la sociologie de Michel Crozier et Erhard Friedberg et les travaux récents sur l’économie de la promesse et les « fictions » mobilisées dans les dynamiques organisationnelles. Selon eux, la capacité à imposer une vision crédible ou inquiétante de l’avenir participe à éclairer les coalitions et les comportements présents.
Le chapitre quatre prolonge la modélisation théorique par la présentation d’une théorie du changement à partir des travaux de James Ferguson, William Sewell et Jens Beckert. En quelques mots, les travaux de James Ferguson permettent de montrer comment les pratiques de certaines communautés perdurent grâce aux relations d’interdépendance qui les soutiennent dans le présent, plutôt que par simple héritage culturel ou rationalité économique. Les travaux de William Sewell complètent cette approche en montrant, à partir de l’exemple de la Révolution française, que les transformations d’ordre cognitives doivent être simultanément soutenues par de nouvelles structures relationnelles et institutionnelles pour devenir effectives. Enfin, les travaux de Jens Beckert formalisent une différence entre « institutions formelles », « cadres cognitifs » et « réseaux sociaux », et montrent l’intérêt d’étudier leurs interactions, leurs ajustements ou leurs tensions pour expliquer le changement. Partant de ces résultats, Henri Bergeron et Patrick Castel distinguent trois structures à l’action collective – les structures cognitives désignent les schémas d’interprétation, valeurs et croyances partagées par les acteurs ; les structures institutionnelles renvoient aux règles formelles, aux procédures et dispositifs organisationnels en vigueur ; et les structures relationnelles désignent l’agencement du pouvoir et des ressources entre acteurs ou organisations (qui dépend de qui, qui contrôle quelles ressources, etc.) – et introduisent l’idée que « l’alignement » et le « désalignement » entre elles expliquent la reproduction ou le changement d’un ordre social. Plus précisément, leur alignement renforce la probabilité d’une forme de stabilité tandis que leur désalignement favorise la réflexivité, le contournement des règles et la prescription de normes alternatives. Suivant cette lecture, le changement n’oppose pas de facteurs exogènes et endogènes, mais peut venir simultanément de plusieurs sources, de façon spontanée ou planifiée, et peut être le résultat de divers décalages entre les trois structures citées plus tôt.
Le chapitre cinq illustre les propositions de l’ouvrage à partir de deux cas. Dans la lutte contre la toxicomanie d’abord, les auteurs montrent qu’un triptyque – doctrine psychanalytique, réglementation restrictive et hiérarchie hospitalière – verrouille l’usage de la méthadone avant d’être fissuré par l’irruption du VIH. L’alliance entre cliniciens, associations et réformateurs reconfigure alors les logiques d’interdépendance (une structure relationnelle) et fait basculer la norme vers la réduction des risques. L’exemple de la cancérologie offre ensuite, à rebours, l’illustration d’une innovation défensive. Les auteurs exposent comment cinq directeurs de centres de lutte contre le cancer, menacés de marginalisation, ont redéployé leurs ressources (recherche clinique, collégialité décisionnelle) et converti leurs concurrents – centres hospitaliers universitaires et Ligue contre le cancer – en partenaires pour asseoir le modèle des cancéropôles, bientôt consacré par le Plan cancer. Dans les deux cas, le moteur du changement n’est ainsi ni la « bonne idée » ni le décret venu d’en haut, mais la reconfiguration des interdépendances et l’interaction continue entre des visions rivales, où les entrepreneurs combinent neuf et ancien pour stabiliser un ordre révisé.
Enfin, le chapitre six prolonge l’analyse en terrain programmatique à partir de trois thèmes : la décision publique, l’innovation et la « crise du travail ». En croisant d’abord les concepts de « rationalité limitée » et de « structures de pouvoir », les auteurs montrent que nombre de choix « irrationnels » sont compréhensibles dès lors que l’on reconstitue la position des décideurs dans leurs dépendances réciproques. Ils montrent ensuite que la circulation d’une innovation ne relève ni d’un simple effet de mimétisme, ni de sa seule efficacité, mais du degré d’ajustement entre cadres cognitifs, règles institutionnelles et coalitions locales (les outils de gestion ne se déploient par exemple dans une organisation que lorsqu’ils redéfinissent avantageusement certaines interdépendances internes). Enfin, ils proposent une relecture originale de la « crise du travail » comme « crise de la coopération » : la rationalisation du travail entame la capacité des acteurs à valoriser et investir le collectif et fragilise en conséquence la réciprocité de leurs engagements. À rebours des préconisations des pouvoirs publics, la solution relèverait donc moins de l’empilement d’incitations symboliques à la coordination que de la restauration de temps et d’espaces où les acteurs peuvent effectivement collaborer.
L’Organocène est un ouvrage ambitieux et stimulant, qui réussit le pari d’être à la fois une somme, par la revue critique des travaux existants, et une théorie originale de la décision, de l’action collective et du changement. Ce livre a également la qualité de ne pas seulement s’adresser aux sociologues des organisations, qui trouveront certes matière à revigorer leurs analyses, mais aussi aux acteurs publics soucieux de comprendre les ressorts de l’action collective et à tous les chercheurs en sciences humaines et sociales intéressés par la modélisation d’un cadre théorique cherchant à dépasser les oppositions entre institution et individu, structure et action, pouvoir et domination. Ce cadre repose en outre sur la discussion d’une littérature peu connue en France, essentiellement anglo-saxonne, qui a le double intérêt de dialoguer avec d’autres disciplines comme le management, la gestion et l’économie, et de réaffirmer la pertinence de la sociologie pour penser le changement dans les sociétés modernes. Enfin, en insistant sur l’importance des relations de pouvoir et en déplaçant la focale à une échelle d’analyse mésologique – chose souvent prescrite et plus rarement appliquée – Henri Bergeron et Patrick Castel proposent une boîte à outils, aussi bien théorique que méthodologique, pour analyser les freins et les leviers à certains grands défis comme la transition écologique, l’innovation numérique et technologique ou les métamorphoses du travail. C’est là, il nous semble, une contribution importante aux débats sociologiques actuels.
Sans remettre en question la qualité de l’ouvrage, quelques remarques pourront nourrir la discussion. D’abord, si la revue de littérature est assurément une contribution forte du livre, sa densité peut aussi en affecter la compréhension et interrompre le fil de la démonstration. Ensuite, si l’une des forces du modèle théorique tient à son caractère intégratif et si les auteurs montrent de façon très convaincante les limites de chaque registre (idéel, institutionnel, relationnel) pris isolément, la grammaire de leur combinaison reste parfois ambiguë. Par quels enchaînements, à quelles conditions ou à partir de quels seuils certains discours peuvent par exemple modifier une structure relationnelle ? Suivant le même raisonnement, comment évaluer le degré d’alignement cognitif au sein d’une organisation ? En résumé, si le modèle est conceptuellement clair et élégant, son opérationnalisation appelle à être testée pour en affiner la portée et l’applicabilité.