Recension : Aurélia Mardon, Prendre de la hauteur. Escalade en salle et fabrique du genre à l’adolescence (2024, Presses universitaires de Lyon)
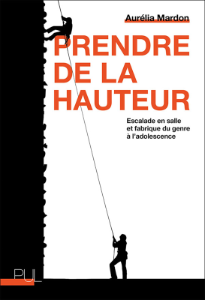
Aurélia Mardon (2024), Prendre de la hauteur. Escalade en salle et fabrique du genre à l’adolescence, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 224 p.
Recension version post-print par
Margaux Rolland
margaux.rolland@inrae.fr
Doctorante en sociologie à l’Université de Bourgogne, rattachée au CESAER (Centre d’économie et de sociologie appliqué à l’agriculture et aux espaces ruraux) et au laboratoire Triangle ; UMR CESAER INRAE Institut-Agro-Dijon, 26 boulevard Docteur Petitjean, 21000 Dijon, France
L’ouvrage d’Aurélia Mardon, Prendre de la hauteur. Escalade en salle et fabrique du genre à l’adolescence, poursuit les travaux entrepris par les sociologues de la socialisation, intéressés par les processus qui conduisent à l’engagement dans un sport et les effets de cette pratique sur l’intériorisation de normes de genre ou de position de classe. Cette démarche, qui vise à comprendre les dispositions à s’orienter vers certaines activités sportives dans l’enfance[1] comme à l’âge adulte[2], est ici prolongée en mettant la focale sur l’adolescence. Cela se justifie par l’importance de cet âge de la vie dans la construction du genre ainsi que par la centralité des loisirs sportifs dans les styles de vie de cette classe d’âge. L’ouvrage, en faisant dialoguer les champs de la sociologie du sport, des classes sociales et du genre, propose une analyse précieuse de l’escalade en salle, pratique en plein essor, et un éclairage stimulant sur la « façon dont “s’incorporent” les masculinités et les féminités » (p. 7) sur la scène sociale du sport à cet âge.
Le régime de genre[3] identifié par Aurélia Mardon dans ce sport est qualifié d’ambivalent. S’il s’agit d’une pratique sportive mixte, qui n’apparait pas être un bastion de la virilité (contrairement à l’alpinisme, par exemple[4]), les positions institutionnelles comme l’excellence sportive y restent accaparées par les hommes et les appropriations de la pratique vont plutôt dans le sens d’un maintien que d’un estompement des hiérarchies de genre – comme l’auteure le démontre au fil de l’ouvrage. L’enquête effectuée repose sur des observations et des entretiens auprès d’une trentaine d’adolescent⋅es âgé⋅es de 10 ans à 20 ans, pratiquant l’escalade en loisir comme en compétition. La sociologue a aussi interrogé une dizaine de leurs parents, quelques moniteur⋅ices et président⋅es de trois clubs d’escalade, situés pour l’un dans une commune de l’ouest de l’agglomération parisienne et pour les deux autres dans des communes socialement contrastées d’une autre agglomération française.
À partir de ce dispositif d’enquête qualitatif et comparatif, l’auteure s’attache dans une première partie à décrire les socialisations familiales, de genre et de classe qui disposent les grimpeur⋅ses à entrer puis rester dans cette activité de loisir ou de compétition. Elle s’emploie à décrire les différents projets éducatifs situés socialement, qui se voient confortés par le choix de l’escalade selon leurs conceptions des « bonnes » féminités et masculinités. D’une part, l’enquête confirme la tendance des classes moyennes et supérieures à investir la pratique sportive sur le mode compétitif, modalité par laquelle les dispositions à la réussite sociale s’incorporent. Ce résultat se décline selon le genre : la pratique de l’escalade est envisagée par les parents comme un levier pour renforcer le goût pour la compétition des garçons et comme une manière de former des « filles fortes », physiquement comme psychologiquement, quitte à remettre en cause l’ordre du genre. D’autre part, il ressort de l’enquête que la pratique populaire, plus souvent de loisir en raison des localisations et de l’offre des clubs, est moins valorisée par les familles pour la performance sportive que pour la pratique collective. Pour autant, elle sert aussi le projet de promouvoir une forme de féminité respectable, distanciée de celles associées à d’autres pratiques sportives (CrossFit, boxe ou parkour), jugées viriles. La pratique masculine est quant à elle tolérée par les familles populaires en raison des profits symboliques qu’elle procure. Elle permet en effet aux garçons comme Idriss, « perdant » sur la scène très concurrentielle du sport-roi qu’est le football, de « réussir » dans une activité qui valorise des dispositions au sérieux et aux relations pacifiées, contraires à celles des « codes de la rue ».
La deuxième partie présente les « cadres » des interactions participant à cette socialisation sportive, dans une perspective goffmanienne. Elle se déplie en trois volets : après être revenue brièvement sur le cadrage contextuel (spatial et temporel) des interactions observées, l’auteure présente le cadre d’action « juvénile », où elle travaille la question des injonctions genrées à adopter certains comportements à cet âge spécifique. En particulier, elle montre que la mixité n’est pas synonyme de mélange et d’effacement des genres à l’escalade, mais d’une co-présence qui a pour effet d’assigner à des rôles genrés. Comme sur d’autres scènes sociales, les filles sont ici amenées à manifester discrètement leur disponibilité sexuelle tandis que les garçons doivent exprimer ouvertement leur hétérosexualité. Le régime de genre de l’escalade en apparence favorable aux femmes charrie en réalité des modèles de féminité et de masculinité traditionnels. Les commentaires exprimés en compétition sur le corps des grimpeuses jugées déviantes car « trop musclées », qualifiées de « monstres », en sont le signe. Ils exposent d’ailleurs ces enquêtées aux « féminités parias[5] » à une moindre valorisation sur le marché amoureux que celles conformes aux normes de « féminité mesurée ». Ce cadre d’action juvénile peut cependant être concurrencé ou amendé au gré des « cadres pédagogiques » rencontrés, c’est-à-dire des modèles et pratiques pédagogiques des encadrant⋅es d’escalade. Ces dernier∙es transmettent par l’organisation des séances comme par les (ou l’absence de) remarques faites aux sportif⋅ves des injonctions de genre plus ou moins égalitaristes ou reproductrices d’un ordre genré inégalitaire et différentialiste. L’ouvrage a pour grande qualité de s’appuyer sur le développement de cas empiriques concrets et précis pour répondre aux questions théoriques qui sont posées, ce qui est fait à plusieurs reprises avec le parcours de Lucie, monitrice de 15 ans. Ce portrait illustre la valorisation différenciée de styles de féminité au gré des sphères de socialisation et des groupes d’appartenance étudiés. Dans son lycée professionnel populaire, la féminité « virile » de Lucie (style vestimentaire unisexe, goût pour l’univers du métal, concours de traction avec les garçons) est stigmatisée et dominée, en raison de sa remise en cause de l’hégémonie masculine, par ses camarades qui incarnent une « féminité accentuée » (Connell, 1987). Pourtant, Lucie occupe plutôt une position dominante dans la salle d’escalade, en raison de la valorisation de la compétence sportive dans cet espace sportif local. Ses performances sportives et sa puissance musculaire sont reconnues et sources d’admiration, là où elles sont discréditées par ses homologues féminines au lycée. Son statut est renforcé par son couple avec un grimpeur et par sa fonction d’encadrement, qui lui permet de transmettre aux enfants le modèle corporel égalitaire qu’elle incarne.
Après avoir montré dans les deux premières parties que l’escalade en salle est un lieu de socialisation où normes de classe et de genre sont co-construites et intériorisées au fil des interactions, la dernière partie propose de manière originale et convaincante de prendre du recul – si ce n’est de la hauteur – sur les modèles de masculinités et de féminités incorporés par les jeunes. La question est simple : la pratique d’un sport mixte et aux caractéristiques a priori moins spécifiquement féminines ou masculines conduit-elle à l’effacement de la bi-catégorisation hiérarchisée des sexes, de leurs pratiques et performances ? Sans surprise et sans cynisme, si une sous-partie porte sur la « capacité d’agir » qu’offre l’escalade aux jeunes filles en termes de dépassement de soi et indique que ce sport incarne un « défi pour la féminité accentuée » (p. 153), la réponse n’en est pas moins univoque : l’escalade n’est pas un lieu de construction égalitaire entre filles et garçons, mais un lieu où l’hégémonie se reconfigure plus qu’elle ne disparaît[6]. S’il n’est pas socialement acceptable dans un espace comme la salle d’escalade de dénigrer la pratique féminine, les garçons pour qui le sport est un enjeu de maintien du statut social (ceux identifiés dans l’enquête comme de classe supérieure, investis en compétition, parfois en échec scolaire) se distinguent des filles par leur appropriation de la pratique. En effet, le régime de genre local les amène à se spécialiser dans des techniques sportives sexuées : le modèle de féminité « hégémonique » ou « accentuée » (conforme à l’ordre du genre) conduit les filles à adopter un style de grimpe orientée vers la technique afin de contourner leur manque de puissance supposé, tandis que les garçons optent pour la force. Ces techniques du corps influencent en retour des différenciations corporelles sexuées à un âge charnière, où les garçons développent une forte musculature du haut du corps tandis que les filles affûtent leur rapport entre poids et puissance par le travail d’un corps plus svelte. De ce fait, les garçons vont « renforcer leur force physique, leur compétitivité et ainsi construire une masculinité complice de la masculinité hégémonique » (p. 196), tandis que les filles vont contrôler le développement de muscles, entérinant par-là la distinction sexuée des manières appropriées de faire de l’escalade et leur valence différentielle. Cependant, ces modèles font l’objet de résistances au gré du positionnement social des grimpeur∙ses. L’auteure constate de telles distances dans le cas des filles de classes populaires, qui ont acquis le goût d’une musculature développée et visible (y compris du haut du corps) par leur socialisation familiale et l’actualisent à l’escalade. De même, les garçons de classes populaires, majoritairement impliqués dans une pratique de loisir, se montrent proches d’une masculinité inclusive, qui reconnait la performance féminine et rejette les comportements homophobes dont ils ont été témoins dans leurs expériences passées (au football, à l’école ou au quartier) et qu’ils ont souhaité mettre à distance.
Après avoir décliné les modèles identifiés sur ses terrains, l’auteure parvient à une conclusion importante, à rebours de préjugés qui associent souvent les attitudes viriles et conservatrices aux classes populaires : ici, les garçons à la masculinité hégémonique, c’est-à-dire qui travaillent à la reproduction de la domination masculine et en tirent les bénéfices, sont plutôt les mieux dotés socialement, et la contestation des normes de genre est moins le fait des filles de classes supérieures que celles de classes populaires. Pour préciser et complexifier ce résultat congruent avec d’autres travaux[7], on aimerait en savoir plus quant à quelques propriétés contextuelles supplémentaires, telles que les pentes des trajectoires sociales des enquêté∙es, ou encore leurs propriétés socio-résidentielles et partant, les espaces sociaux locaux[8] dans lesquels leur quotidien (sportif ou non) s’inscrit. D’une part, cela permettrait d’envisager la pratique atypique de l’escalade par les garçons de classes populaires sous le prisme de l’affinité de ce sport avec leurs dispositions scolaires et le rôle éventuel qu’elle peut avoir dans leur perspective d’ascension sociale. D’autre part, creuser plus en détail les « effets de lieux », autrement dit ces « cadres spatiaux » rapidement présentés en introduction et en deuxième partie, aurait été stimulant pour réfléchir aux alliances et distances entre groupes de sexe et de classe dans la salle d’escalade et à la variation potentielle, entre les trois salles étudiées, des modèles de féminité et de masculinité localement valorisés.
En somme, cet ouvrage mobilise de manière opportune la littérature spécialisée concernant les concepts de masculinités (notamment R. Connell), de féminités (introduction des travaux non-traduits de M. Schippers) et leurs déclinaisons respectives (hégémoniques ; conquérante, orthodoxe, inclusive pour les premières ; accentuée, paria, alternative, mesurée pour les secondes) pour tenter de penser les distinctions sociales sur la scène des loisirs, articulant les rapports sociaux de classe et de genre. S’il a le mérite de présenter ces concepts et de les mobiliser de manière souple pour permettre une écriture incarnée et accessible à un lectorat élargi, on peut regretter le manque de discussion critique de ceux-ci, de telle sorte qu’à la fin de la lecture, ces typologies n’en ressortent pas beaucoup plus unifiées et triées, ni discutées en termes de domaines et conditions d’application. Un futur livre plus théorique sur la question pour compléter ce type d’enquête empirique serait bienvenu.
- Bernard Lahire (dir.) (2019), Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants, Paris, Seuil. ↑
- Christine Mennesson (2005), Être une femme dans le monde des hommes. Socialisation sportive et construction du genre, Paris, L’Harmattan. ↑
- Raewyn Connell (1987), Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics, Sydney, Allen & Unwin. ↑
- Delphine Moraldo (2015), « Les conquérants de l’inutile. Expression et diffusion d’un modèle de masculinité héroïque dans l’alpinisme français d’après-guerre », Genre, sexualité & société, no 13. ↑
- Mimi Schippers (2007), « Recovering the Feminine Other. Masculinity, Femininity, and Gender Hegemony », Theory and Society, vol. 36, no 1, p. 85-102. ↑
- Haude Rivoal (2021), La Fabrique des masculinités au travail, Paris, La Dispute. ↑
- Laurie Dinier (2025), « Une musculature sous influences. Construction sociale des normes corporelles chez les CrossFiteuses », Sciences sociales et sport, vol. 25, no 1, p. 97-128. ↑
- Ivan Bruneau, Gilles Laferté, Julian Mischi et Nicolas Renahy (2018), Mondes ruraux et classes sociales, Paris, Éditions de l’Ehess. ↑